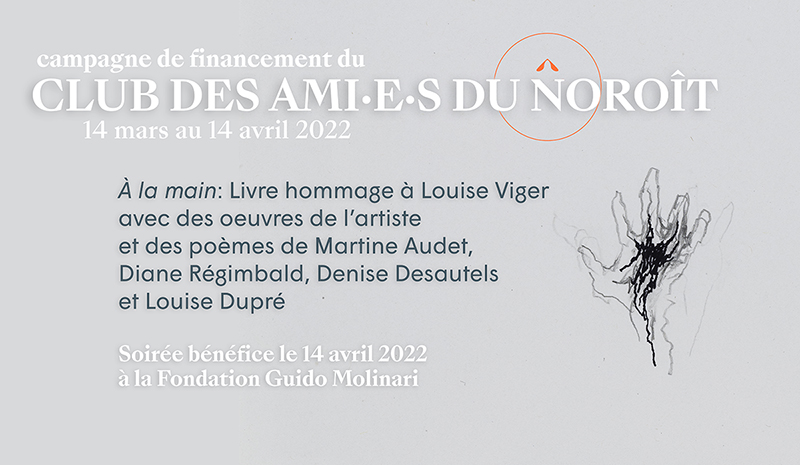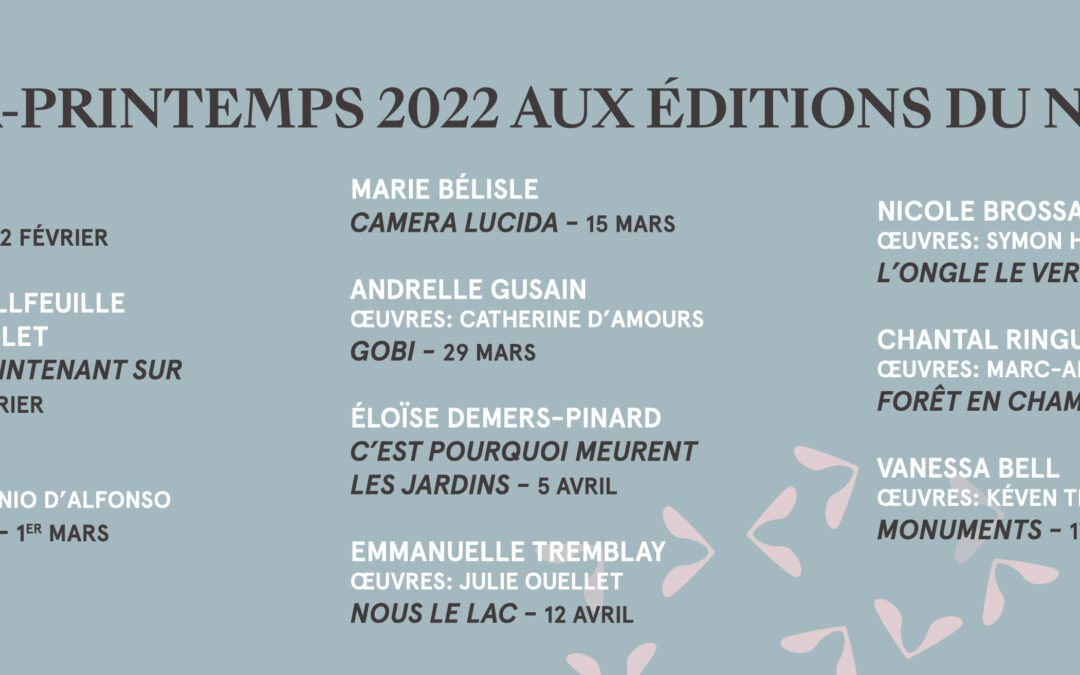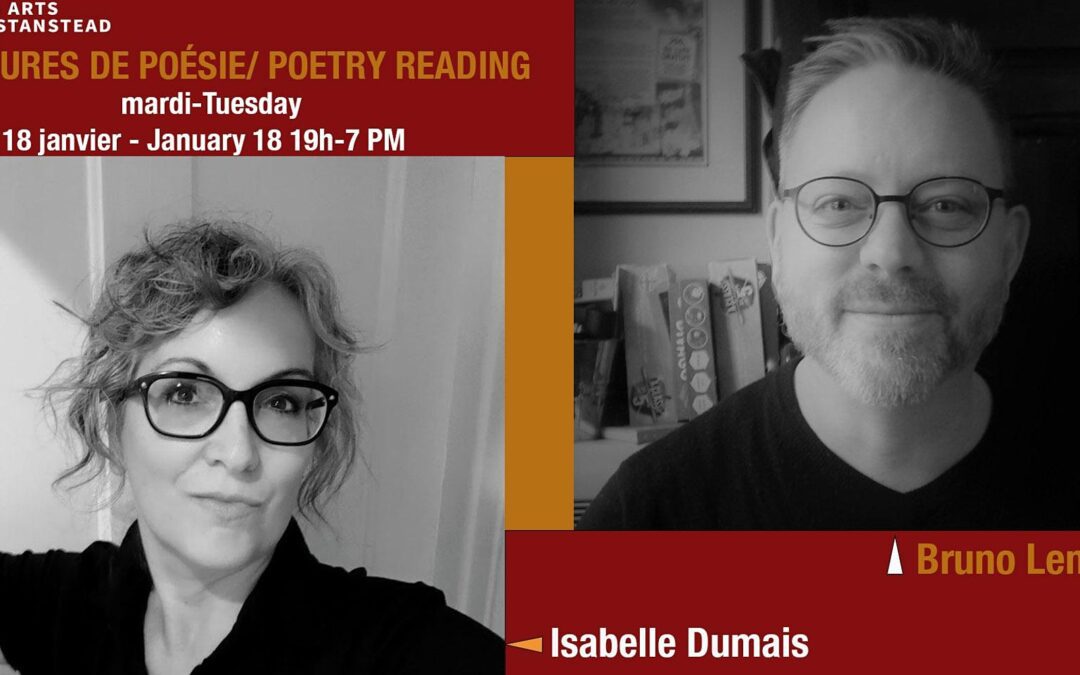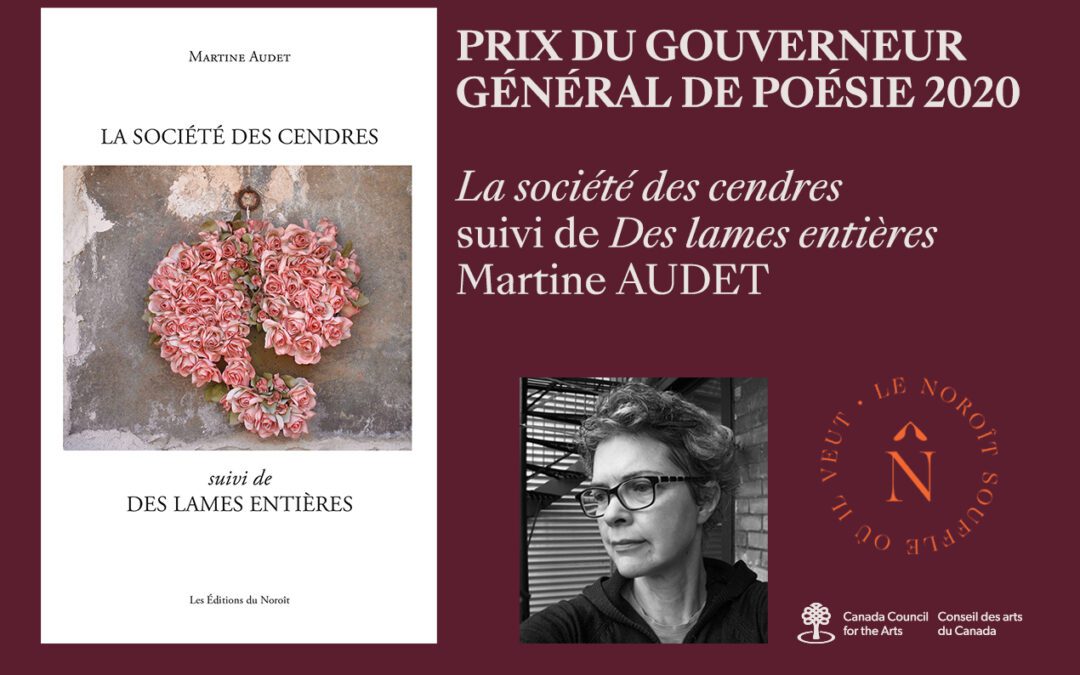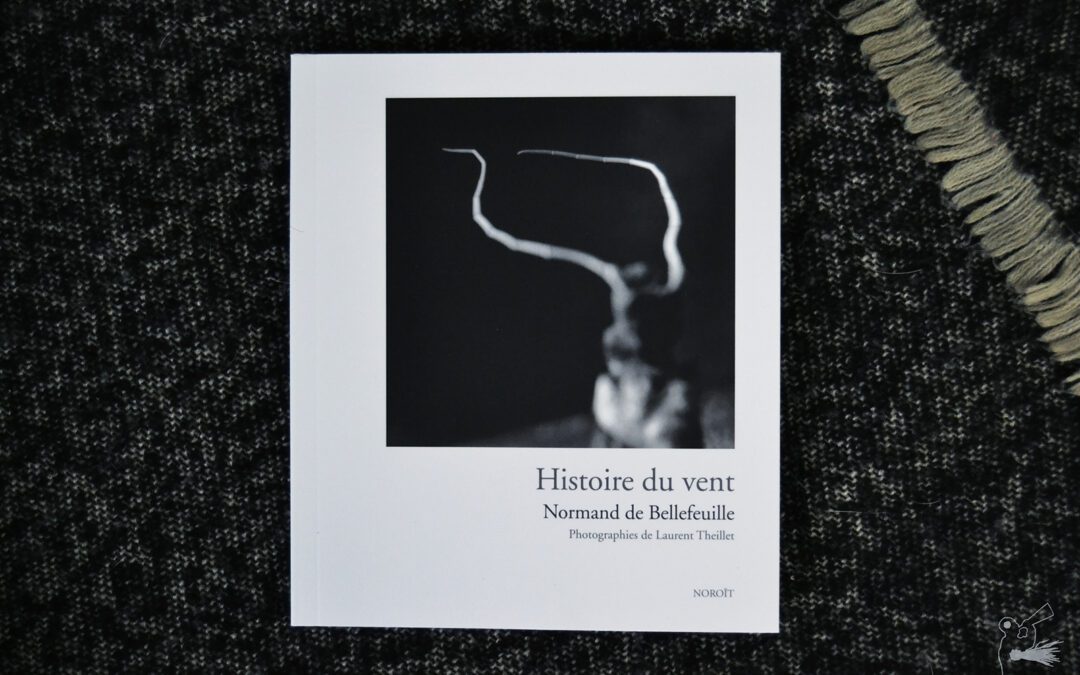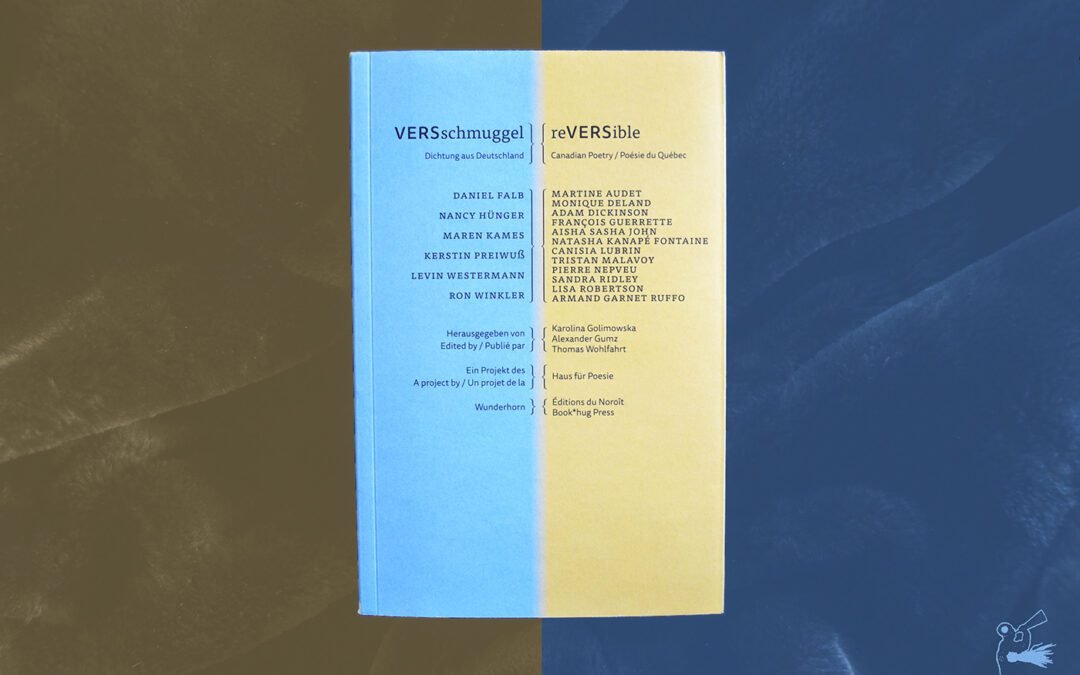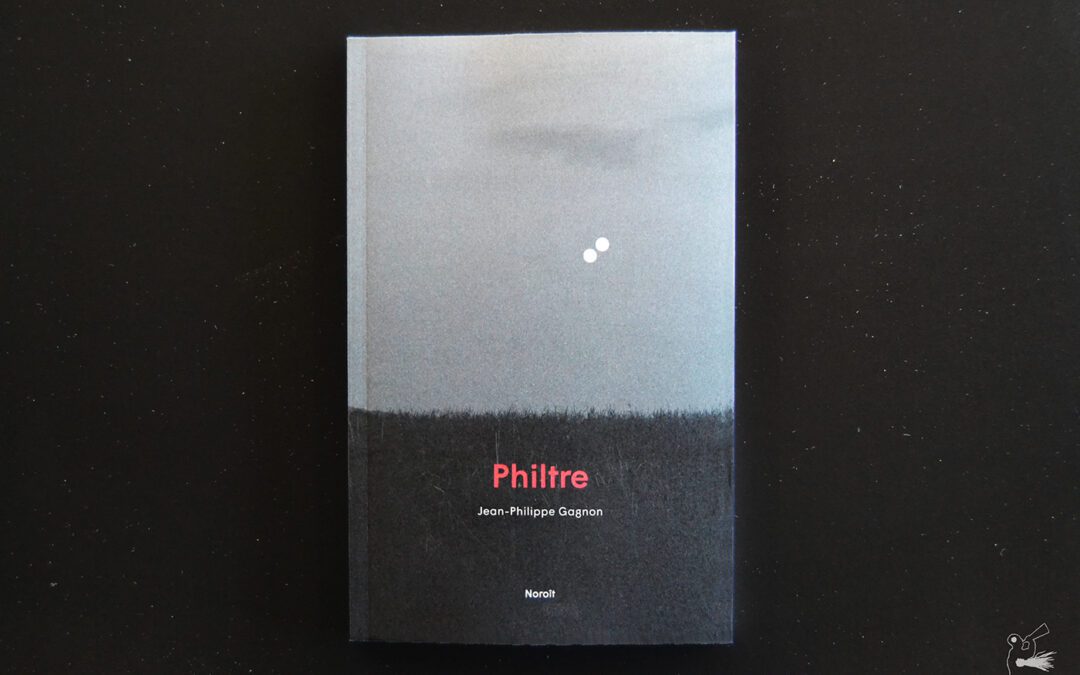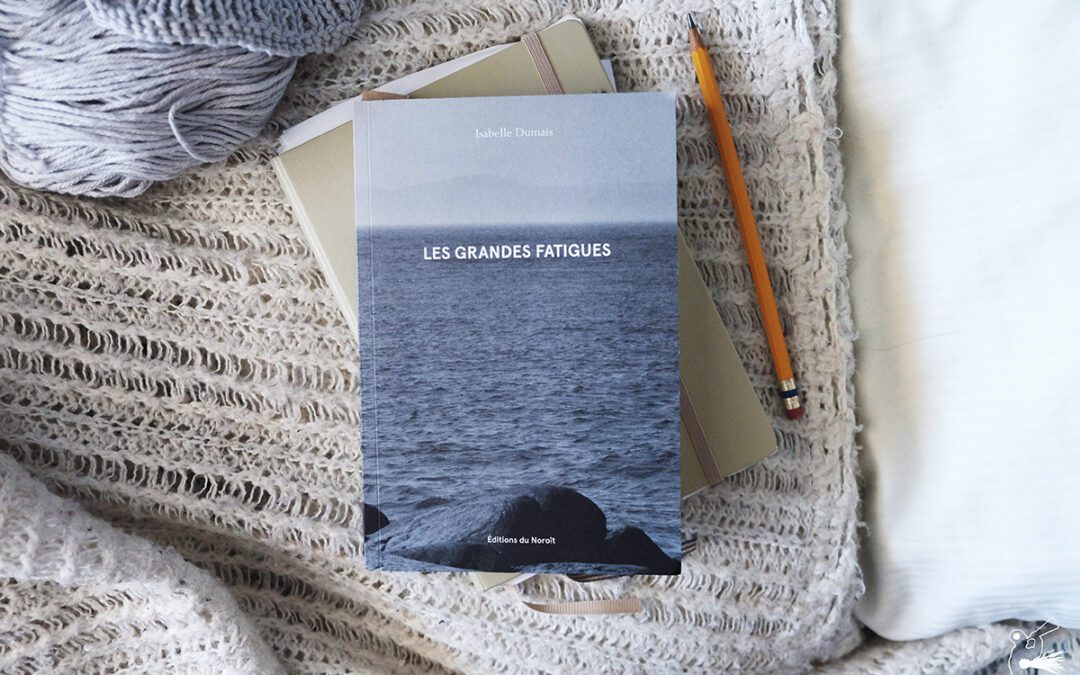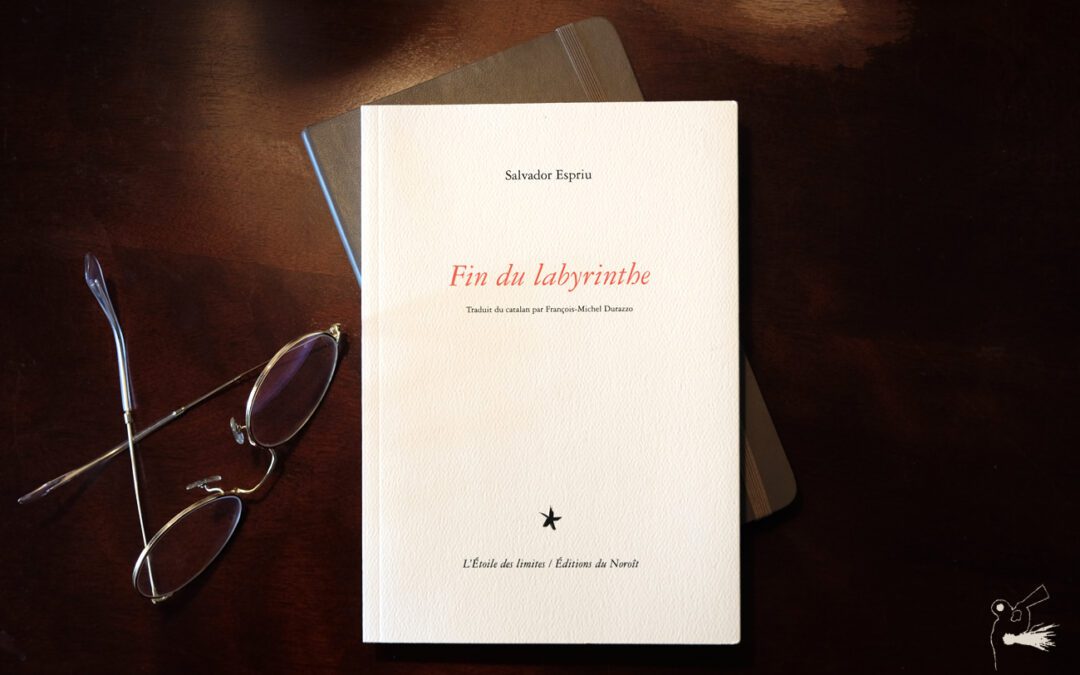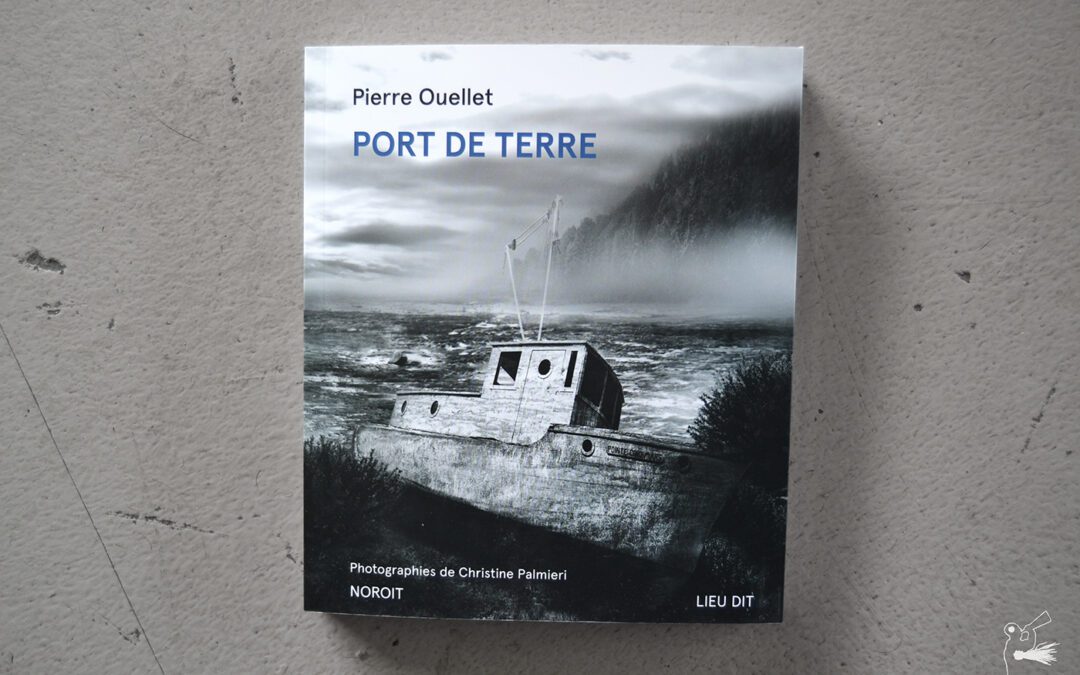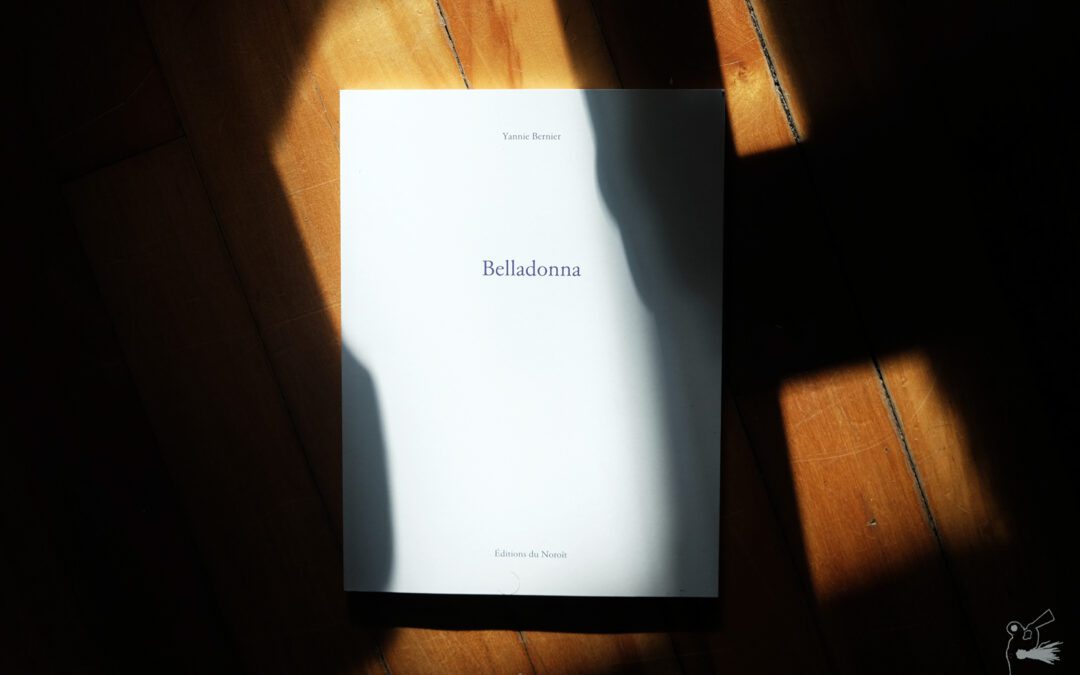Conversation entre Paul Bélanger et Chantal Ringuet autour de son recueil de poésie Forêt en chambre (2022).
Paul Bélanger – On aborde la forêt comme s’il s’agissait d’un temple…
Chantal Ringuet – On la découvre peu à peu sous un nouveau jour et elle apparaît avec toutes ses richesses.
D’entrée de jeu, la citation de Rilke annonce un changement de perspective : le temple renvoie à la tradition grecque, ce qui produit un contraste saisissant avec la tradition yiddish associée à la diaspora et dont il est question en filigrane du recueil. Plus précisément, il y a ce contraste entre le lieu sacré où l’on célèbre le culte de l’une ou de plusieurs divinités et les écrivains et membres de la communauté yiddish qui ont été assassinés sans avoir de tombe (telle la mère de Korn, qui « repose dans une forêt de Pologne » sans pierre tombale). Nous sommes proches ici du sanctuaire, mais sous une forme désacralisée, un peu comme dans les textes de Leonard Cohen. Et plus on avance dans le recueil, plus cette forêt se révèle sensuelle.
Intuitivement, j’ai pensé ouvrir le recueil avec cette citation de Rilke, car il demeure l’un des plus grands poètes que je lis et relis au fil des ans. Par ailleurs, Rilke était l’un des principaux poètes qui ont beaucoup compté pour Rachel Korn.
P.B. – Et pourquoi « en chambre » ?
C.R. – Il y a des territoires intimes que l’on découvre à l’intérieur de soi. Il s’agissait ici de retrouver le chemin de la contemplation en suivant les traces d’une écrivaine dont la voix m’habite (Rachel Korn) dans quelques sentiers familiers. Il s’agissait également de regarder la forêt depuis une perspective intérieure, pour réaliser ensuite qu’elle a ouvert une nouvelle chambre, un espace de création, en soi.
En un sens, ce recueil s’inscrit en continuité avec la réflexion qu’a menée Virginia Woolf dans A Room of One’s Own / Une chambre à soi. Il prend d’abord la forme d’un voyage dans le passé, entre les forêts du Québec (Montréal) et de la Pologne ; puis dans le présent, à travers l’expérience sensorielle et amoureuse. J’y vois aussi un écho à Philippe Jaccottet, poète que je fréquente depuis longtemps, en particulier à une phrase que le poète a écrite à propos de Palézieux : « Le paysage lui-même a souvent quelque chose d’une chambre » (Remarques sur Palézieux, 2005).
D’abord, la forêt nous ramène à l’écrivaine Rachel Korn, à son univers qui se compose de nombreux souvenirs associés aux forêts de la Pologne et de l’Europe de l’Est qu’elle a connues durant l’enfance. Cette forêt intérieure est aussi une forêt blessée : elle porte la déchirure, l’empreinte d’un trauma à la fois personnel et collectif : celui de la Shoah. Avec elle vient le trauma de la « langue assassinée », ou plus globalement ce que j’appelle « l’arbre du yiddish déraciné ». Pour cette écrivaine de langue maternelle polonaise qui avait choisi d’écrire en yiddish et pour ses contemporains, c’était une véritable catastrophe, comme l’évoque le terme hébreu.
La poésie de Korn incarne cette forêt qu’elle a intériorisée et qu’elle nourrit : s’il n’y a pas le culte de dieux ou de héros, c’est plutôt un culte de la langue à travers les espaces verdoyants. Et c’est le mont Royal qui devient sa forêt d’accueil pendant les quatre dernières décennies de sa vie.
Dans la deuxième partie, on se dégage de Korn et on entre dans la forêt-corps, ou dans l’espace amoureux. Encore ici, c’est une « chambre » en forêt que les amoureux construisent. « Forêt en chambre », c’est aussi une manière d’aborder nos arborescences dans un contexte de vie et d’amours en exil, ou qui n’entrent pas dans les normes habituelles.
Enfin, « en chambre » comprend une autre signification : il s’agit également d’entrer dans la chambre d’écriture comme dans la chambre de traduction. J’ai commencé à traduire Korn il y a plusieurs années ; et peu à peu, la traduction a fait place à la création littéraire, comme en rendent compte les traces qu’elle a laissées dans ce recueil.
P.B. – Tu ouvres avec « Roses de papier », puis « De l’autre côté du poème ». Quel lien y’a-t-il à faire avec l’être « égaré dans le temps » ?
C.R. – Au parcours géographique s’ajoute en effet un parcours dans le temps, puisque le texte défile en amont de la vie de Korn dans la première partie, de sa vie mature à Montréal jusqu’à ses jeunes années en Pologne et dans les cercles littéraires de Varsovie durant l’entre-deux-guerres. Je ne l’avais pas planifié ainsi, mais c’est ce qui a découlé du travail d’écriture et de composition.
Le premier chapitre s’intitule Roses de papier – c’est aussi le titre d’un recueil de Korn (Papierene royzn) – et il s’ouvre avec ma traduction d’un très beau poème yiddish de la poète, De l’autre côté du poème (Fun yener zayt lid). Petite note, l’original (le texte en alphabet hébraïque) se trouve à la fin du recueil. Dans cette tradition, il faut le rappeler, les textes se lisent de droite à gauche ; on ouvre donc un livre en commençant par sa dernière page. En ajoutant le poème yiddish à la fin du recueil, je voulais créer une rencontre entre ces traditions qui se reflète aussi dans la structure du texte. Il s’agissait ici de trouver le détail délicat qui tisse des liens entre ma voix, celle de Korn et la tradition yiddish (ouverture de gauche à droite).
Dans le poème de Korn, l’être « égaré dans le temps » est celui qui, après la Shoah, est confronté à la totale perte de ses repères.
En réalité, ce recueil est tout en tissages : tissages de voix et de bruissements, de silences et de chuchotements où des secrets se dissimulent, où des blessures se cachent dans les feuillages et dans la terre. Ceux-ci renvoient tantôt à la violence et à la mort, tantôt à la sensualité, au rêve, à l’amour, au désir d’absolu et aux désillusions qui ponctuent nos vies.
P.B. – Un poème yiddish apparaît. Quel rôle a-t-il dans cette forêt, dans cette chambre ? Pourquoi les insertions de la poète t’interpellent-elles ? Font-elles écho à ta poésie – à cette adresse que tu fais à la mémoire ?
C.R. – Je dirais que le poème yiddish évoque la forêt à plusieurs égards, tout en la rassemblant. Mais son rôle est beaucoup plus que cela aussi. Le poème permet ici d’entrer dans une relation organique avec la nature, à travers le souffle, la voix, les bruissements… Il prend aussi la forme d’une traversée de l’histoire récente du XXe siècle, à travers le parcours de Korn et des accompagnements multiples qui se glissent dans le texte : der vald-ruekh, par exemple, c’est l’esprit de la forêt dans la poésie yiddish de l’entre-deux-guerres en Europe chez un auteur symboliste comme Der Nister.
Dans ce recueil, il s’agissait aussi de désencombrer un certain imaginaire de la forêt d’après lequel notre identité – québécoise, nord-américaine – se construit en rapport avec le territoire, à savoir l’espace géographique arborescent qui nous précède et qui nous survivra : son immensité, sa démesure, sa beauté. À notre manière particulière de posséder le territoire (ou de le détruire, ou encore de le protéger et de le sauver), d’y trouver un ancrage majeur.
Le mont Royal, par exemple, est associé à un imaginaire faste dans la littérature montréalaise. Ici se rencontrent diverses traditions : francophone, anglophone, yiddish… Avec la présence de Rachel Korn, la perspective change un peu : la montagne gagne en relief. La voix de la poète, tout comme celle des écrivains qui m’accompagnent dans le recueil, permet d’approfondir ce lien qui m’unit à la montagne, mais aussi à diverses traditions, ainsi qu’à la mémoire collective des violences du XXe siècle.
Ce n’est pas un simple regard sur le présent ou le passé, sur l’ici et le maintenant ; pas seulement une parole de femme qui s’approprie la forêt ou qui tend la main à une autre femme. C’est ce qui s’écrit en soi, cela même qui découle du fait d’être habitée par la forêt.
Il s’agit de traduire une voix – des voix – et les sensations de leur présence et leur immédiateté, tout autant que dans leur mémoire.
P.B. – Et qu’en est-il du lien avec la mémoire de la nature ?
C.R. – J’étais « hantée » par quelques vers de Korn à propos de sa « mère sans caveau / qui repose dans une forêt de Pologne ». Ceci est le socle de sa relation aux arbres, à la continuité qu’ils lui permettent d’établir entre l’avant et l’après qui caractérise la Seconde Guerre mondiale et la destruction de la culture juive d’Europe.
Cela dit, la mémoire trouve difficilement à s’inscrire dans la nature et le poème permet de métaphoriser cette absence de traces qui caractérise ce passage du recueil.
P.B. – Sauver une langue ?
C.R. – De manière générale, sauver une langue, c’est un peu une tâche impossible, car nous n’avons aucun contrôle sur les conditions humaines, sociales et historiques qui mènent au déclin d’une langue voire à sa disparition. Mais la poésie demeure l’un des moyens les plus vivants de le faire. La poésie et, bien sûr, la traduction. Pour moi, il y a aussi un lien intéressant entre l’idée de sauver une langue (le yiddish) et celle de sauver un arbre ou une forêt. Ces deux aspects sont au centre de mes préoccupations depuis quelques années.
Mais il y a plus. Après la Shoah, sauver une langue – leur langue – c’est la tâche inouïe à laquelle étaient acculés les écrivains yiddish. Comment poursuivre l’écriture en yiddish dans un tel contexte, où la majorité de ses locuteurs avaient disparu ? Peu à peu, ces écrivains ont éprouvé le grand drame du yiddish : non seulement leur langue avait été « assassinée », comme l’écrit la traductrice Rachel Ertel ; mais en plus, les jeunes générations n’en voulaient rien savoir, tant elle était associée à un passé douloureux avec lequel il fallait faire table rase.
Mais alors qu’Adorno écrivait qu’il est impossible d’écrire de la poésie après Auschwitz, des écrivaines comme Rachel Korn et Kadya Molodowsky affirmaient plutôt qu’il est essentiel d’écrire de la poésie en yiddish et elles ont continué de le faire jusqu’à la fin de leur vie.
*
Cette question a taraudé voire obsédé de nombreux écrivains yiddish après la Seconde Guerre mondiale. J’aimerais rappeler qu’Isaac Bashevis Singer avait répondu ainsi lors de la remise de son prix Nobel en 1978 : « Les gens me demandent souvent pourquoi j’écris dans une langue qui se meurt. Je veux vous l’expliquer en quelques mots : premièrement, j’aime écrire des histoires de fantômes et rien ne va mieux aux fantômes qu’une langue qui se meurt. Plus la langue est morte et plus le fantôme est vivant, les fantômes aiment le yiddish et ils le parlent tous. Deuxièmement, je crois en la résurrection et je suis sûr que le Messie va bientôt arriver et qu’ainsi des millions de corps qui parleront le yiddish vont sortir de leur tombe. Leur question sera : y a-t-il un nouveau livre en yiddish à lire ? »
P.B. – Revient le jardin où enfouir secrets et souvenirs ?
C.R. – On pense tout de suite à Cohen, à l’anecdote célèbre du souvenir d’enfance qui l’a consacré poète : à la mort de son père, il a griffonné quelques lignes sur un billet qu’il a emballé dans un nœud papillon de son père et qu’il a ensuite enterré dans le jardin. Selon lui, c’était son premier acte en tant que poète. Le jardin est aussi un espace imaginaire qui a beaucoup été investi par les poètes – je pense de nouveau à Philippe Jaccottet, ainsi qu’à Yves Bonnefoy. Ce sont des voix poétiques qui m’habitent depuis longtemps.
P.B. – Les poèmes de Rachel Korn ponctuent ton recueil. Elles sont aussi en écho avec ta voix, comment cela se passe-t-il ?
C.R. – Cela s’est passé d’une manière un peu magique : je ne m’attendais pas à ce que sa voix se lie à la mienne en écrivant. J’ai débuté la rédaction de ce recueil en Islande, je travaillais sur les arbres et sur leur absence dans ce « pays sans arbres ». La voix de Korn s’est imposée dès le départ et elle m’a habitée.
P.B. – « la forêt te dessine
une chambre »
C.R. – Ce vers est central dans le recueil. La forêt, l’univers végétal, invite à l’introspection, à l’évocation du monde sensible que l’on porte.
P.B. – Les poèmes suivent deux trajets : celui d’une mémoire liée à la poète Rachel Korn et à la forêt, et la présence du poète Melech Ravitch, Rainer Maria Rilke, Leonard Cohen, etc., qui participent à tes poèmes comme à un dialogue.
C.R. – La nature permet à la fois une « communion » avec soi et la rencontre intime de l’autre, qu’elle soit littéraire ou amoureuse ; elle permet aussi d’ouvrir des espaces de dialogues avec les autres poètes qui m’accompagnent et qui se présentent comme autant de « chambres » de poésie. Toutes ces présences forgent le recueil, et c’est ainsi qu’on y retrouve un certain renouveau lyrique, si je puis dire.
P.B. – Des projets à venir ?
C.R. – Ce texte en appelle un autre, qui est déjà en cours d’écriture. L’Islande est un pays magnifique et Reykjavik une ville stimulante. Mon séjour d’écriture m’ayant beaucoup interpellée et l’écriture ayant cheminée, j’ai amorcé un recueil qui évoque divers aspects de ce pays et de cette culture.
Parmi les autres projets à venir qui sont intimement liés pour moi à l’écriture poétique, il y a quelques traductions du yiddish et de l’anglais, ainsi que de nouveaux tissages (tricot, broderie). Le travail manuel du tissage enrichit aussi mon écriture : chaque fois, il s’agit de suivre un fil, de créer une texture, de bâtir une forme – avec la particularité, dans le cas de la poésie, de faire apparaître la musicalité du texte : assister à son déploiement.