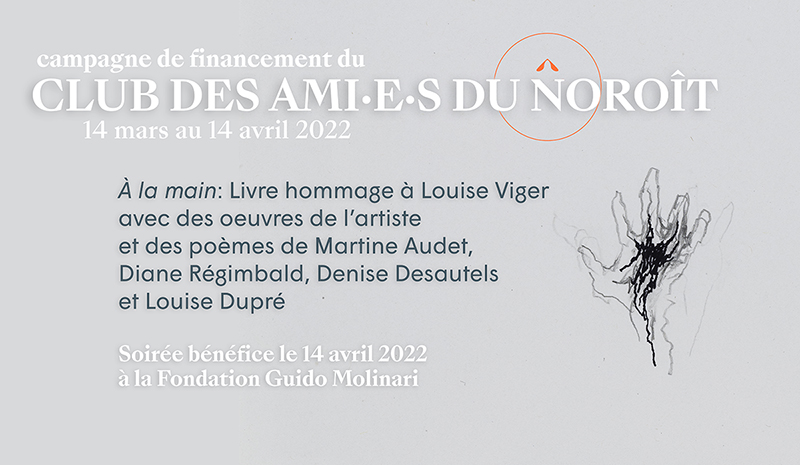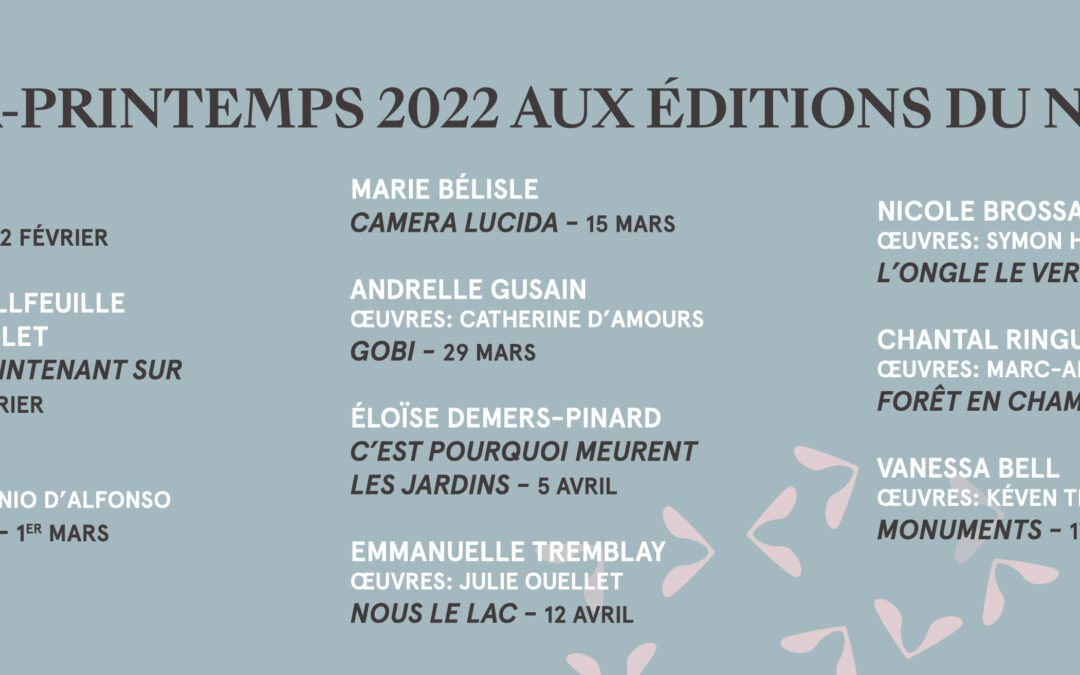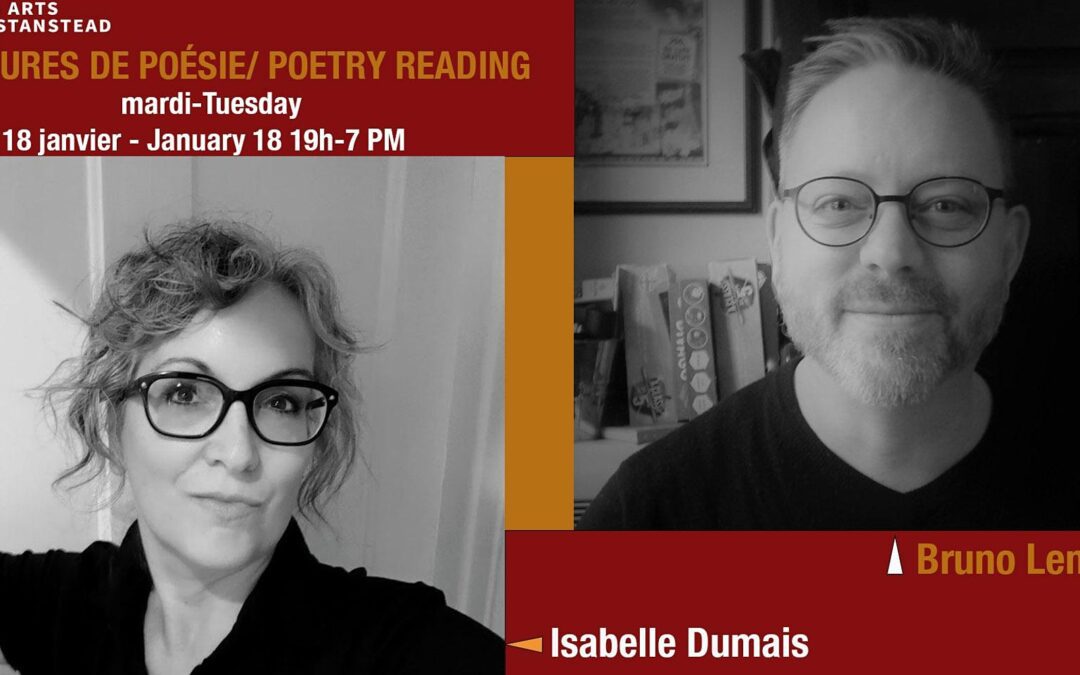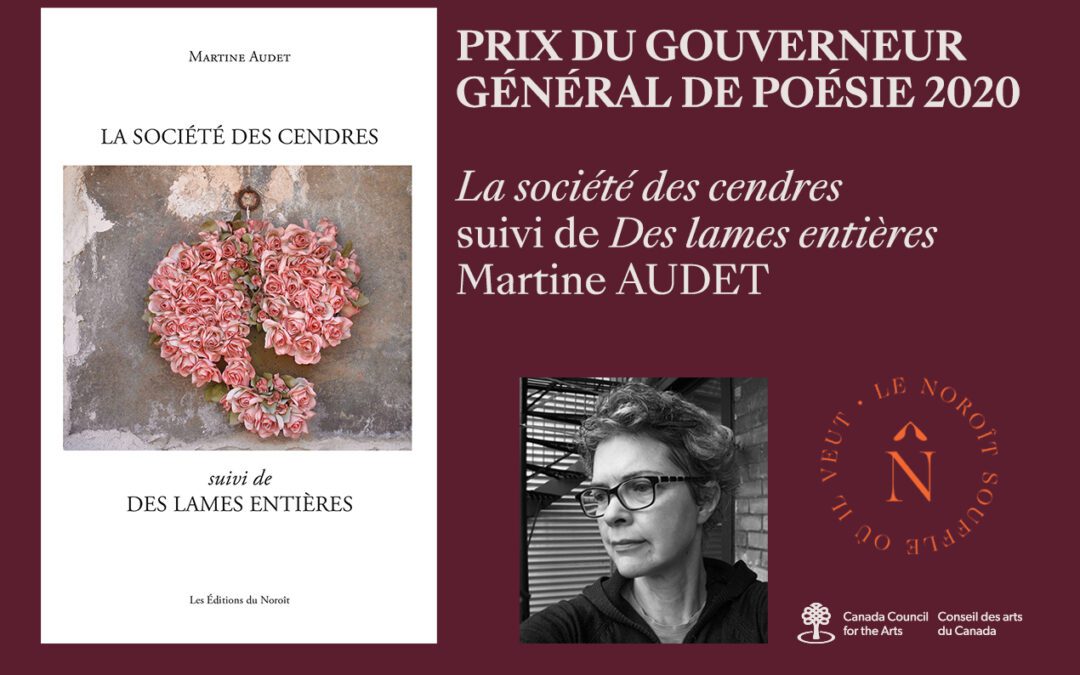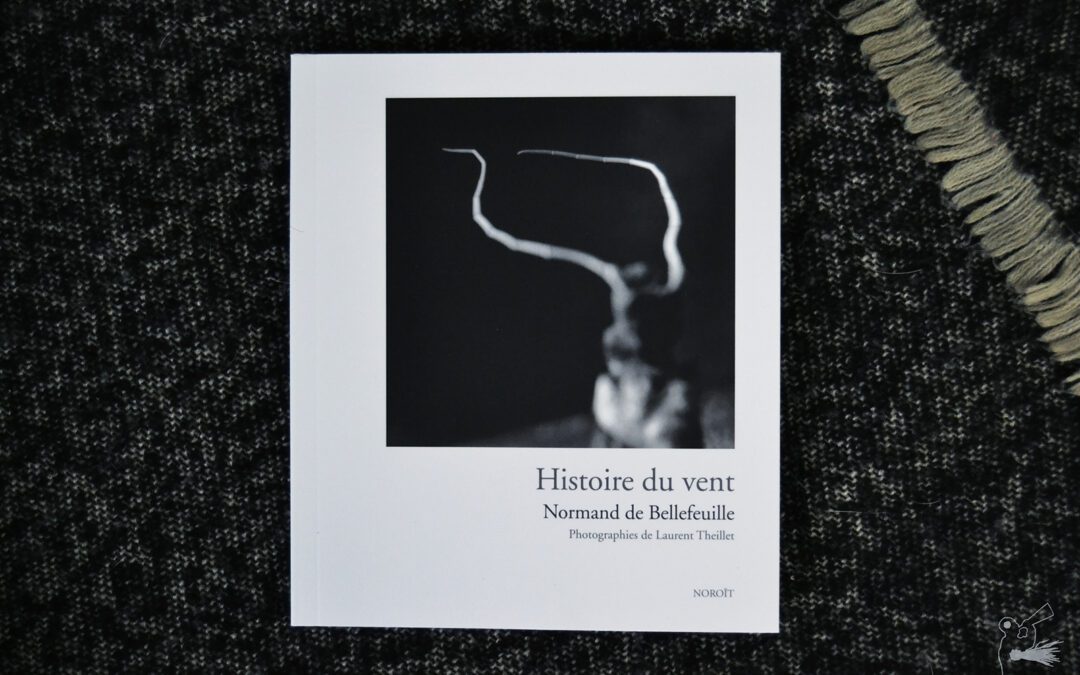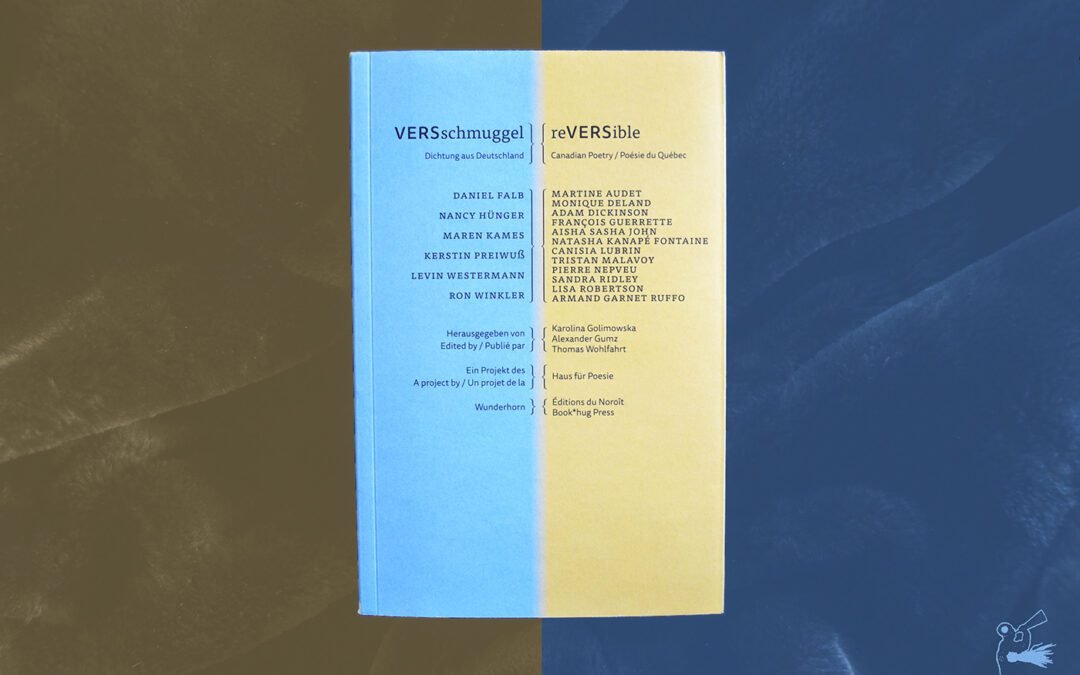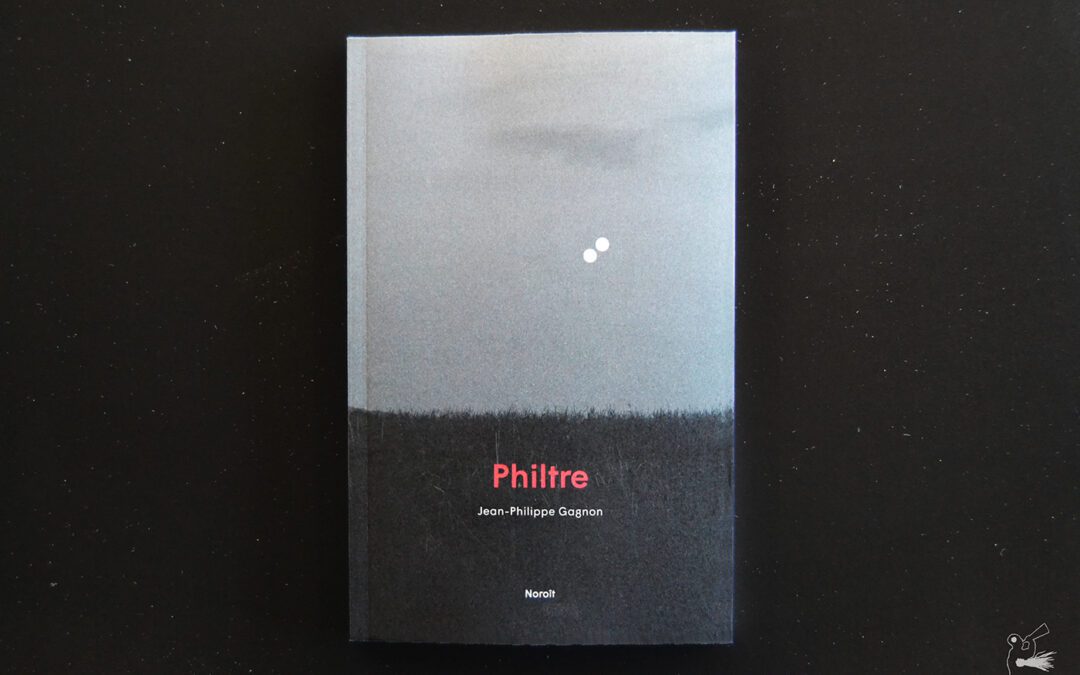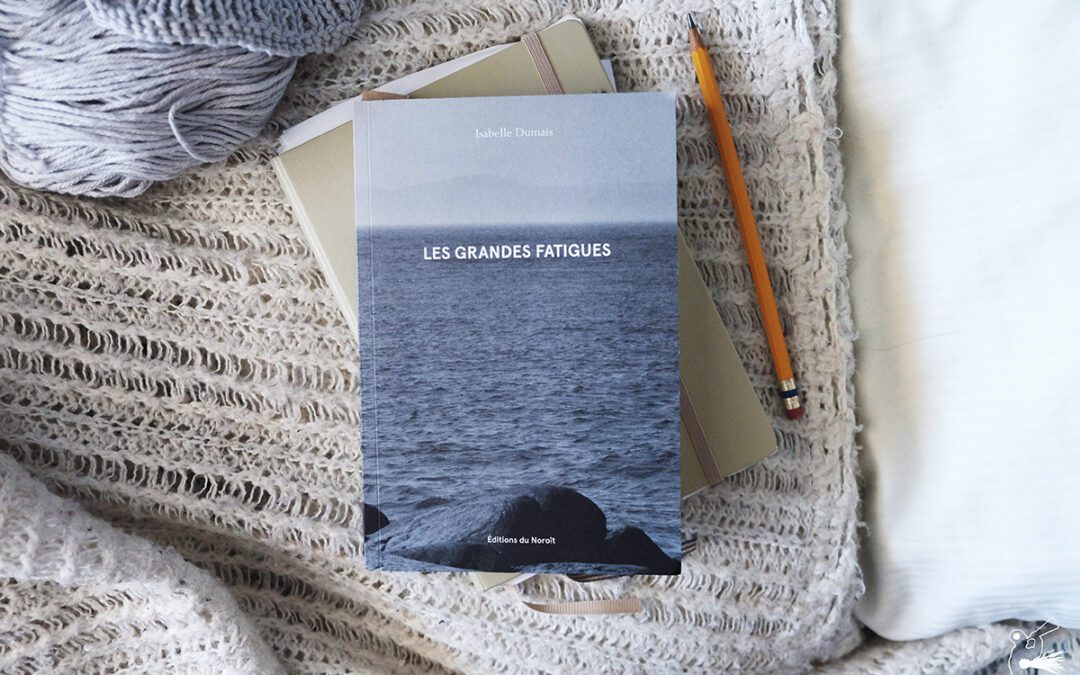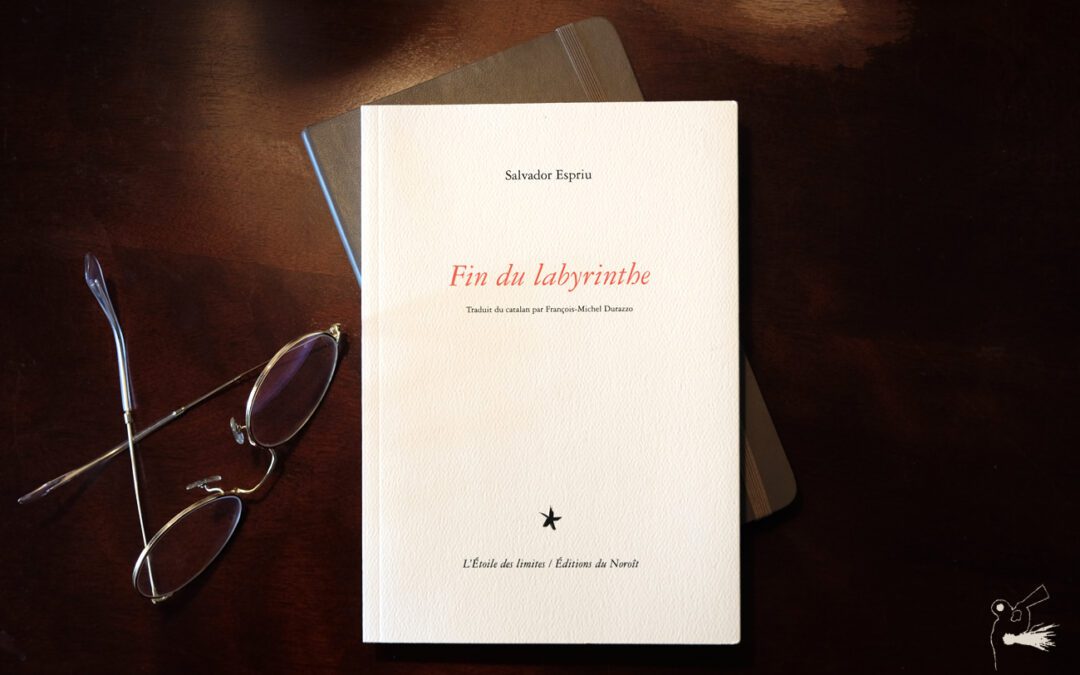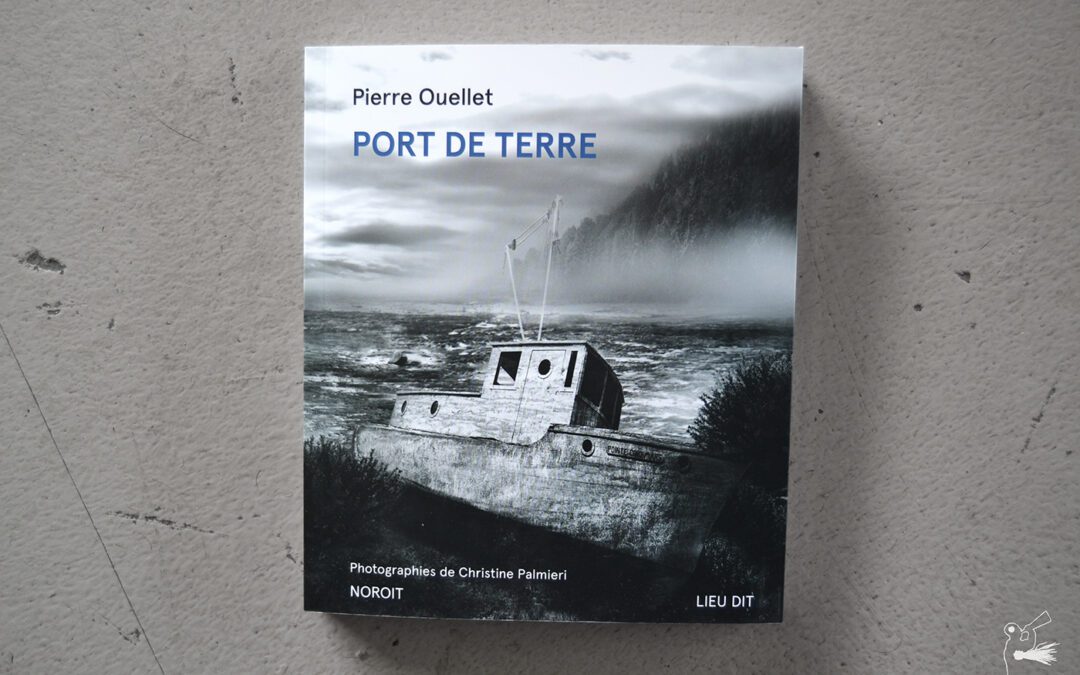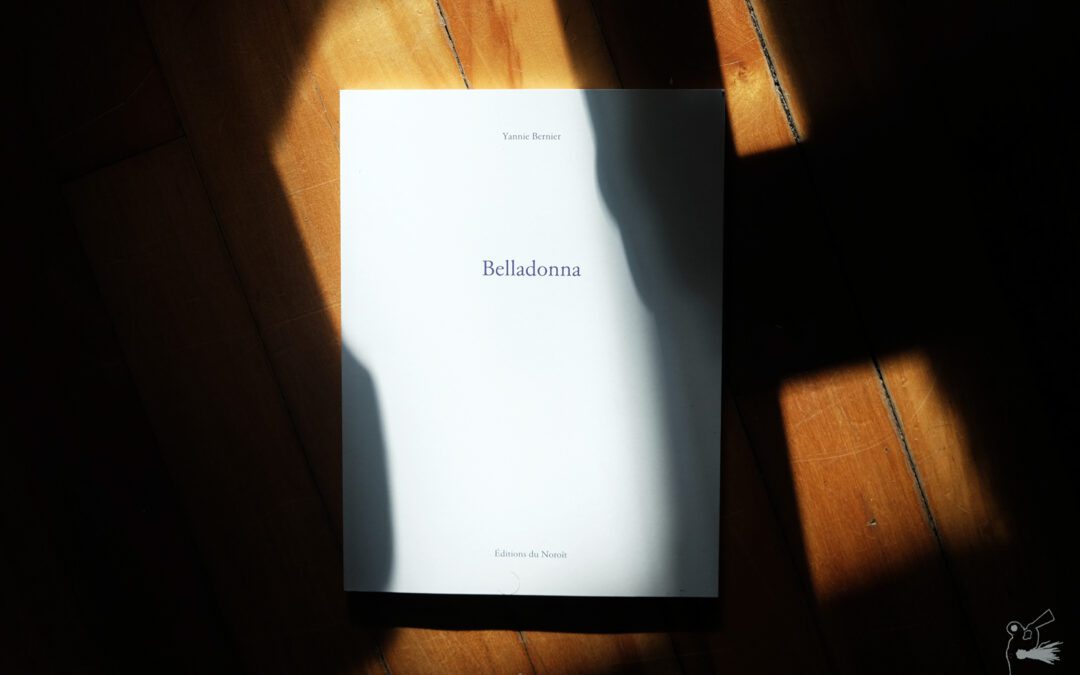Paul Bélanger propose à Marie Bélisle une réflexion, sous la forme d’appels en vers, autour de son recueil Camera lucida
P. B. – La chambre
M. B. – La chambre, c’est le début et la fin. On s’y retire du monde, on s’y endort. On s’y ouvre au monde, on s’y éveille. On y nait et on y meurt, le plus souvent, du moins en nos confortables contrées occidentales. C’est le lieu des contrastes aussi, non seulement entre le clair du jour et l’obscur de la nuit, mais également entre la plus absolue solitude (de la nécessaire chambre à soi à la punition du va dans ta chambre) et l’intimité la plus profonde (de l’abandon de l’amour à celui du sommeil partagé). C’est l’utérus et le cercueil.
P. B. – L’antichambre
M. B. – L’antichambre, c’est la périphérie et l’avant. C’est l’attente et ses hésitations, et ses espoirs, et ses craintes. Un lieu qui n’existe qu’au regard de celui auquel il mène. Là où on pense la chambre à venir et où on repense, aussi peut-être, les chambres semblables déjà visitées, en une sorte de présent abstrait qui superpose les images déjà vues et les images imaginées. Dans l’antichambre, la chambre est tout à la fois projet et souvenir.
P. B. – Que chantent ces chambres
M. B. – Une comptine ? Une complainte ? Qui sait ? Mais nulle berceuse…
P. B. – L’idée des chambres, d’une chambre qui nous visite
M. B. – Il y a les chambres qu’on habite et celles qui nous habitent, comme l’impossible berceuse…
P. B. – Pour un temps unique
M. B. – Ou pour d’éternels retours hors les murs enfin déclos de l’enfance…
P. B. – Passant de l’une à l’autre
toujours semblable
toujours différente
M. B. – On y renait à soi-même ou on s’y perd, toujours semblable, toujours différente…
P. B. – Toutes appellent une expérience
comme des moments d’une vie
M. B. – L’expérience (r)appelée par telle ou telle chambre, le moment d’une vie qu’elle photographie aurait été sans intérêt sans l’écriture. Il n’y aurait pas eu de livre. Un journal intime fragmentaire, tout au plus, qui n’aurait parlé à personne d’autre qu’à moi-même. Pour faire un livre, la mémoire doit devenir matière. Le minerai mnésique doit être évalué à l’aulne de son potentiel, de sa teneur en signes transformables en poème. Et lorsque l’extraction a été faite, lorsque la chambre a été écrite, la réalité biographique personnelle n’importe plus que pour l’écho qu’elle peut faire entendre au lecteur, à la lectrice.
P. B. – « relisant les signes sur le blanc du présent »
M. B. – Entre la chambre noire et la chambre claire, nul gris, nulle couleur. Les objets, les meubles, les pensées, les bruits, (d)écrits pour chaque chambre sont autant d’idéogrammes qui condensent et traduisent des sensations anciennes, sur un mode métonymique. La photo ne peut être qu’en noir et blanc.
P. B. – L’écriture le dessin et la mémoire des lieux
convergence des signes et de l’expérience
M. B. – En concevant le projet, j’ai d’abord vraiment voulu faire un exercice d’exhaustivité, revoir toutes les chambres, en une sorte de jeu avec ma mémoire, tout en sachant, lucidement, qu’il était fort improbable qu’aucune ne se soit effacée de mon souvenir. Sachant, aussi, que je ne saurais pas quelles chambres tomberaient ainsi dans l’inénarrable, puisque, par définition, l’oubli implique qu’on ne sait même pas qu’on oublie. J’ai commencé l’écriture (et le dessin) sur la base de cela qui restait vivant-visible en mon esprit. Puis, pour conjurer la fatalité de l’effacement, je me suis attelée au travail de remémoration : où ai-je dormi en mon enfance ? dans quelles chambres ai-je écrit ? quelles chambres étaient en bord de mer ? etc. Moi qui déteste Excel, j’ai construit un tableau qui listait les chambres. Je les ai classées par catégorie (avec amant, avec mer, de tristesse, littéraires, etc.), j’ai continué à écrire et dessiner, à choisir quelle chambre serait écrite, laquelle ne le serait pas, laquelle encore pouvait tenir en une phrase à peine… Mais je cherchais surtout à constituer une matière suffisante, d’un point de vue littéraire, bien au-delà (ou en deçà) de l’irréalisable convergence des signes et de l’expérience.
P. B. – De la contrainte comme liberté
M. B. – La contrainte n’est liberté qu’en ceci : j’invente les règles qui orienteront l’écriture. Et il y a là pour moi, dans ce travail de conception de la contrainte, un grand plaisir de création. Car chaque projet repose sur ses contraintes propres, plus ou moins dures, chaque projet construit sa propre règle signifiante et il n’y a pas de véritable écriture tant que ce système n’est pas établi. Avant, c’est du brouillon, de l’ébauche. Après, ce n’est pas tant de liberté qu’il s’agit que de productivité, pourrait-on dire : la contrainte implique la recherche, oblige à se détourner de la forme spontanée et permet de trouver ce mot qui répond par sa forme, sa nature, son sens à la règle choisie. Mais n’y a-t-il pas contrainte dès lors qu’on s’attache à écrire avec un tant soit peu de rigueur ?