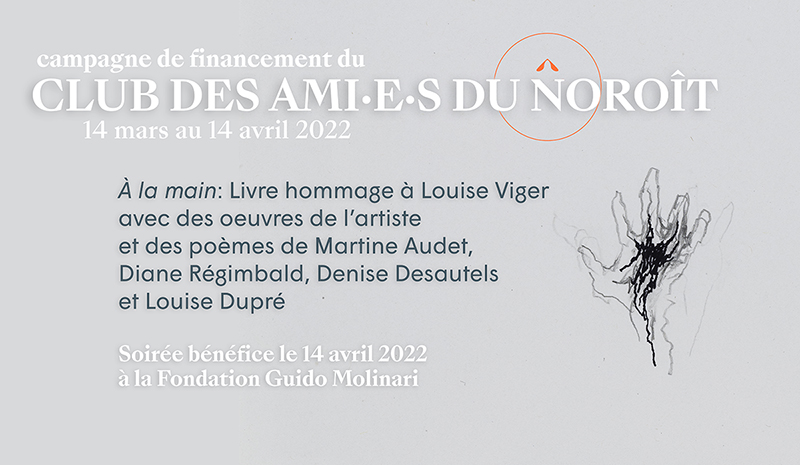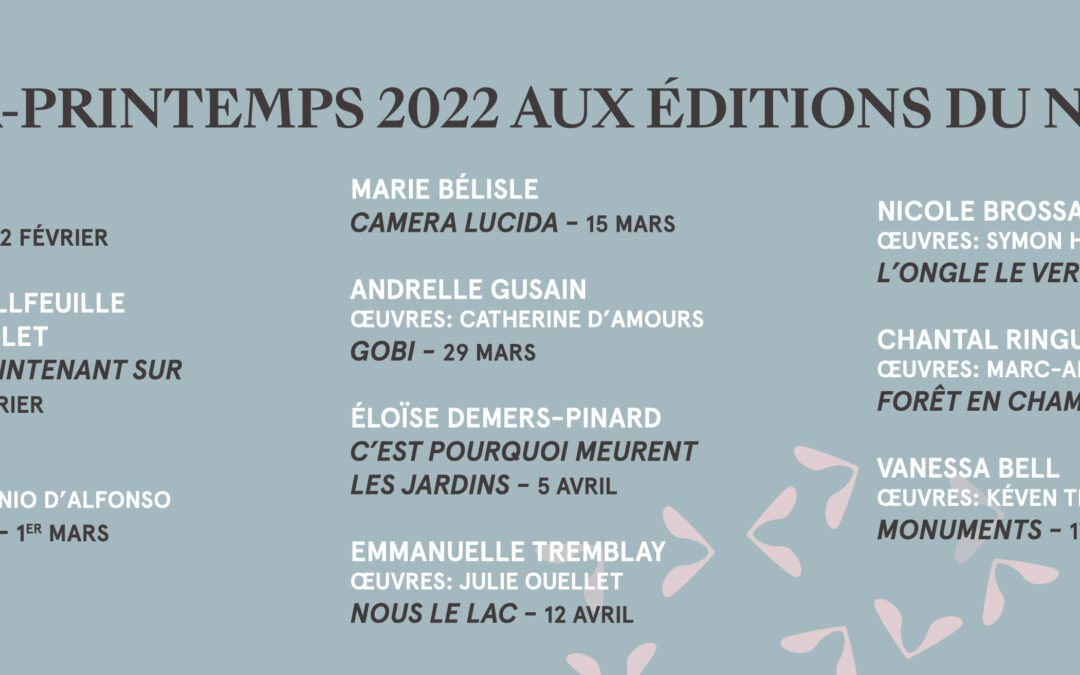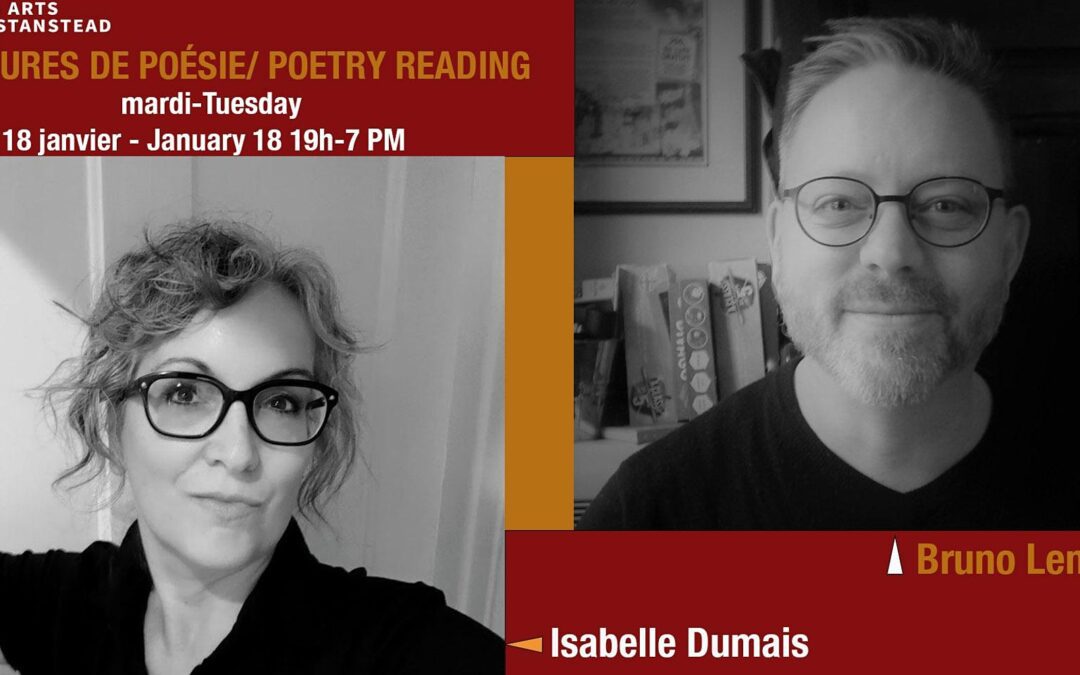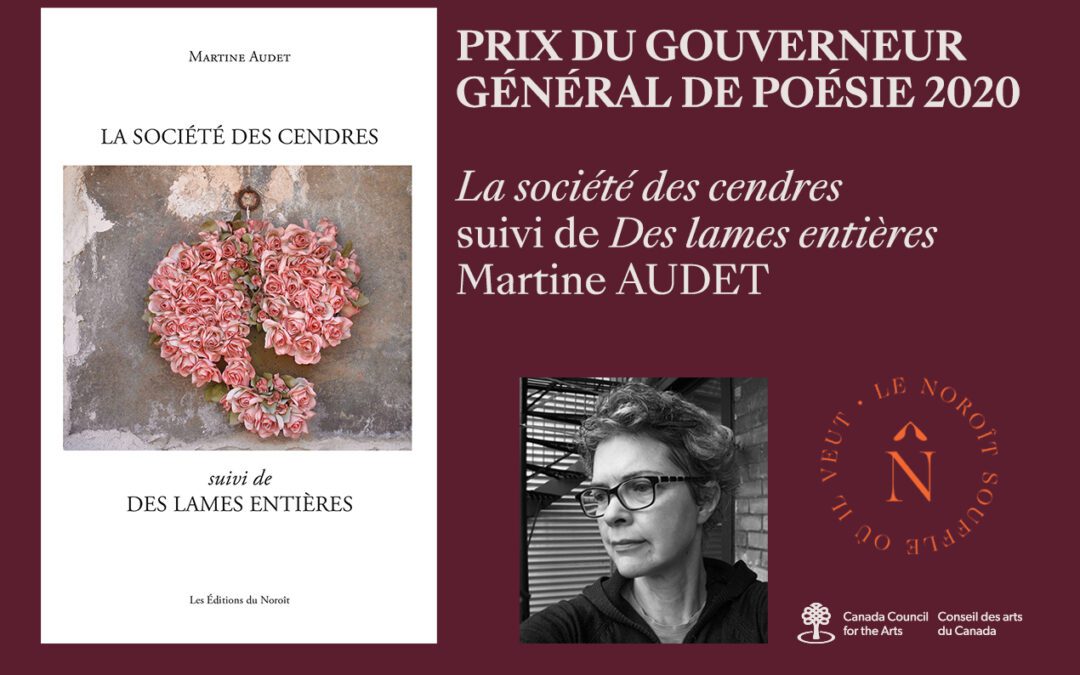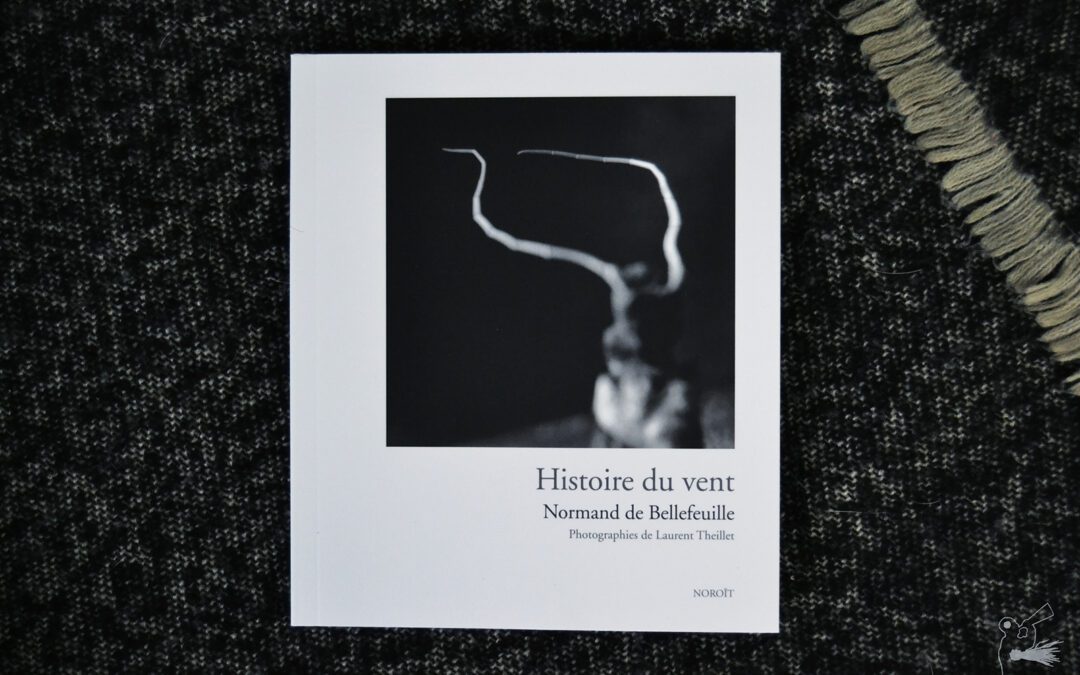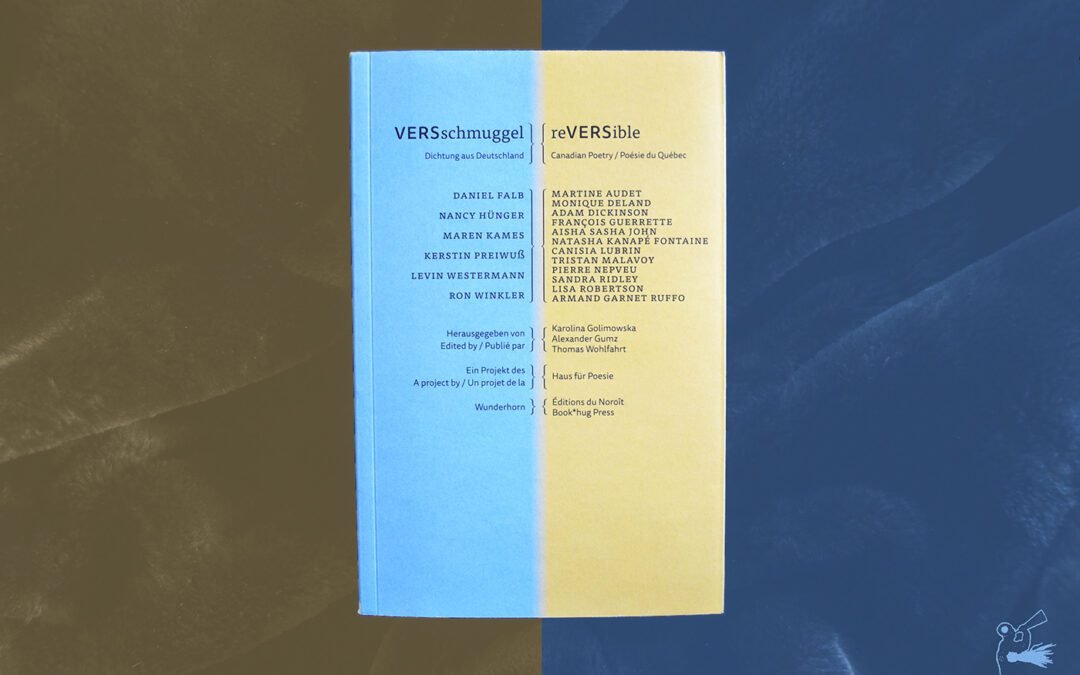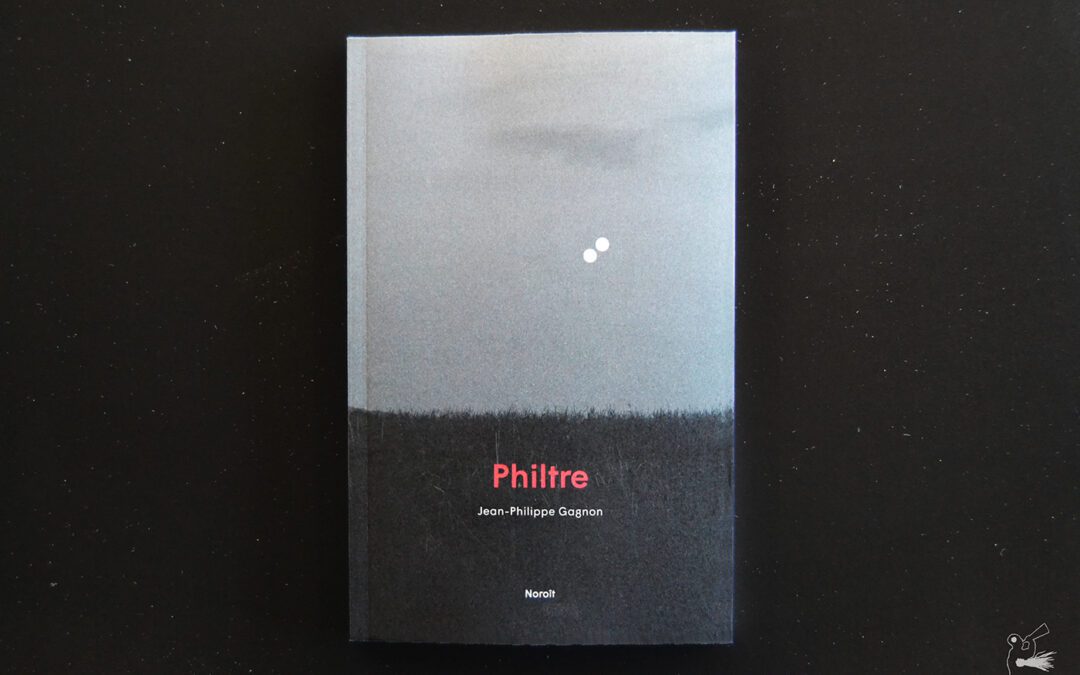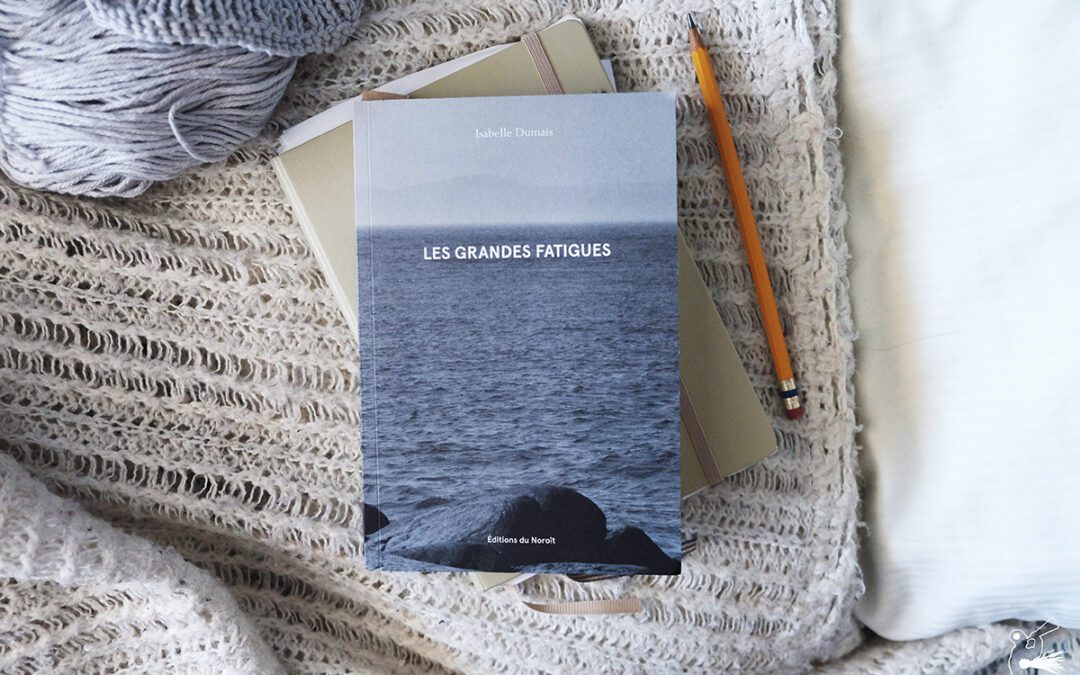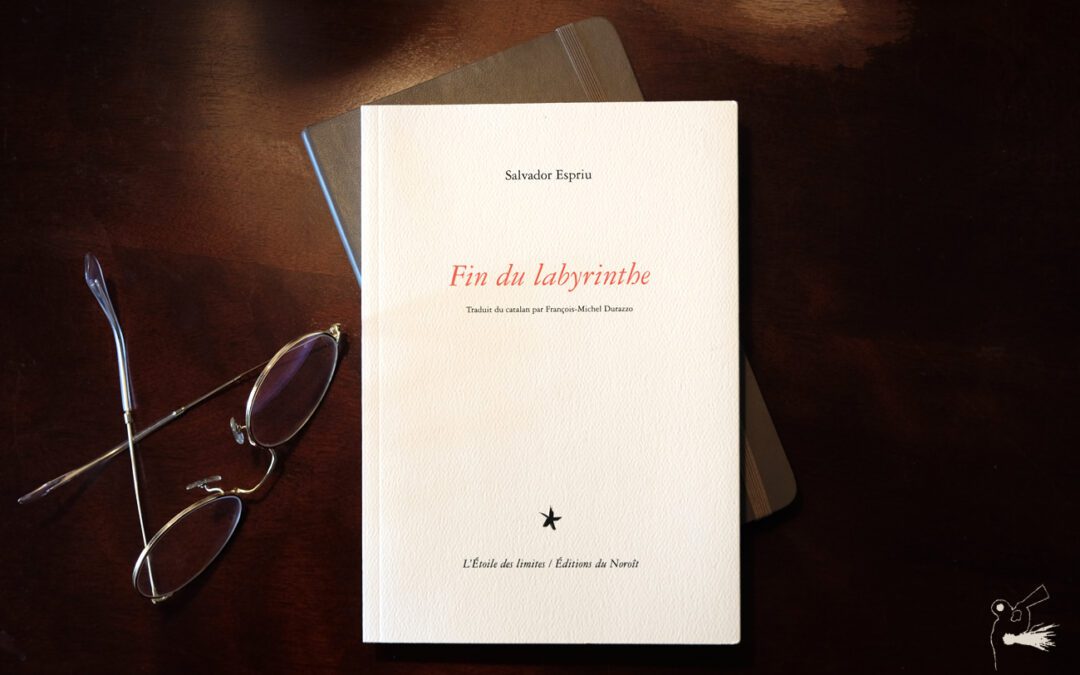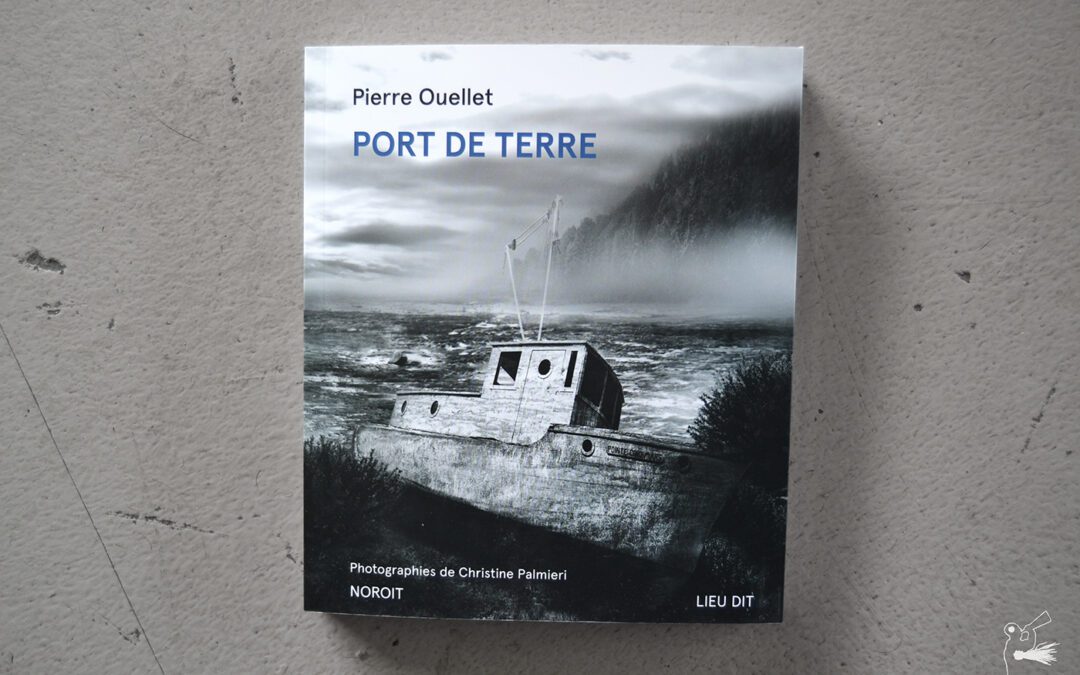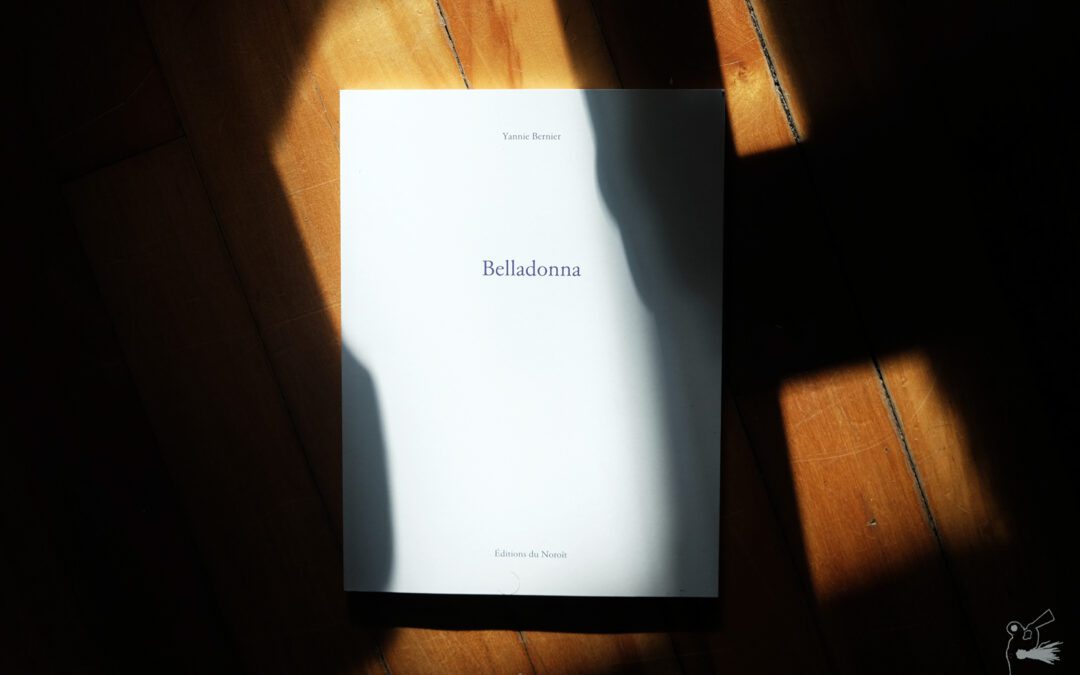Conversation entre Paul Bélanger et Emmanuelle Tremblay autour de son recueil de poésie Nous le lac (2022).

Paul Bélanger – Nous le lac, l’enfance d’un lieu?
Emmanuelle Tremblay – Avec Nous le lac, j’ai inscrit le récit dans un hors temps, en amont des origines biographiques qui s’apparente à ce que Pascal Quignard appelle pour sa part un « monde vivipare ». Espace de pures potentialités, ce monde est celui de la vie interconnectée, étranger à toute forme d’individuation comme le nom masculin ou féminin, par exemple, auquel chacun.e d’entre nous doit correspondre et répondre, selon le sexe.
Quand une histoire trouve-t-elle son véritable commencement? En faisant débuter la mienne dans un espace prénatal, je voulais faire déborder la question des origines des cadres du ventre maternel et du temps de l’enfance. Surtout, il s’agissait pour moi de réaffirmer une dette envers un principe de vie mis en péril par la violence du monde. L’enfance en tant que telle apparaît plutôt, dans le recueil, comme une période charnière de dessaisissement de ces eaux primordiales qui hantent l’expérience du sensible. Tout au long de l’écriture, j’ai cherché à redessiner leur spectre, figuré par le lac, car chaque lieu, chaque expérience vécue rappelle cette appartenance première à la matière. À cet égard, les œuvres de Julie Ouellet, qui enrichissent le livre, créent un effet de schiste, donnent une résonance minérale à cet espace que tu décris bien comme « l’enfance d’un lieu », ou plutôt des différents lieux qui sont déployés.
P. B. – Dans le premier poème du recueil, on peut lire : « tu […] es l’onde première cette part de l’atome qui veut être du monde non pas la victime ni la splendeur ni rien qui ne soit en tout ».
E. T. – La voix qui s’élève d’abord s’énonce au « nous » d’une collectivité de femmes, « ces filles bleues de l’été », pour prendre un vers d’Anne Hébert. Cette voix de la destinée est porteuse d’une vitalité originelle à la fois désirante et domestiquée, du monde intra-utérin à l’âge adulte, bafouée. C’est en raison de cette chronologie que je me suis plu à désigner le fil suivi par l’écriture comme un récit autobiographique, mais ce n’est peut-être pas approprié, car on n’y trouve aucun détail croustillant. D’un point de vue poétique, ce qui m’a intéressée, c’est la manière avec laquelle j’ai pour ma part, en tant que femme, cherché à échapper à ce que j’ai vécu, à vrai dire, comme un confinement dans le genre.
Quand on naît femme, on est d’emblée victime, en raison des rapports d’inégalité dans lesquels on est coincé. Ce qui peut s’accompagner de la honte de se retrouver malgré soi de ce côté-là de la victime, tout comme de celle d’avoir à se soumettre aux modèles imposés. Cette honte, je l’ai ressentie très tôt sans toutefois en prendre conscience avant la maturité. C’est également un thème qui traverse le recueil et qui teinte l’émotion d’une coloration trouble, reliée à une volonté constamment empêchée d’embrasser le monde. On a beau se rebiffer contre les clichés de son sexe, l’intégration sociale dépend d’une adhésion minimale. De ce vécu paradoxal, Nous le lac est un témoignage parmi d’autres.
Toutefois, ce n’est pas tant le sujet que j’ai voulu mettre de l’avant que la composition artistique. En réalité, je me suis appliquée à traduire le rapport aux origines qui a ancré mon corps dans l’expérience de chacun des lieux de mon appartenance : les eaux maternelles, le paysage natal du lac Saint-Jean, la famille, le couple, la mémoire, la collectivité humaine et l’environnement planétaire. Comment rassembler tout ça? Le lac s’est tout de suite imposé comme une métaphore que je dirais holistique, dans la mesure où elle embrasse toutes les périodes et toutes les sphères du parcours décrit.
Dans l’ensemble sont mobilisées des formes poétiques distinctes pour chacune des sections qui interrogent un principe d’unité, selon différents « nous ». Pour pallier les effets de rupture, j’ai toutefois misé sur la répétition des images et je me suis laissé guider par le défi de la mise en récit.
P. B. – Du début à la fin, il y a des nœuds, des loups aussi.
E. T. – Le motif du lac se combine en effet à d’autres images qui traversent tout le texte : le loup, le bleu, la toile et la corde. Pour chaque période de la vie abordée, les matériaux de composition sont les mêmes. Un peu comme dans un travail de tissage, les motifs (ou les images) de base s’entrecroisent dans des trames chaque fois réinventées pour engendrer d’autres images poétiques. J’ai voulu, notamment, recréer une impression de familiarité en rendant reconnaissables, dans la réitération, des motifs tout simples qui sont issus de l’enfance et qui s’animent différemment sous l’effet de leurs variations, ce qui est, bien sûr, une manière de rendre hommage au paysage natal.
P. B. – Dans la découpe du lac, la toile que tu décris, le bleu est relié au Lac Saint-Jean, mais il y a aussi d’autres éléments qui s’y rattachent. Le lac, « cette fatigue », est l’espace des mères et des tantes, de l’attente.
E. T. – Dans la section « Portrait de la toile », les poèmes sont des morceaux d’un héritage en mosaïques où la famille est élargie aux grands-parents et aux tantes, amies. Ces dernières ont été des sources d’identification dont je retiens les désirs fragiles d’émancipation et l’affection désintéressée. J’ai eu la chance de bénéficier d’une enfance non restreinte aux figures parentales, assez libre auprès de la présence douce de mes tantes. C’est avec cette communauté sororale, avec son legs de vulnérabilité et de tendresse que je renouais dans mon second roman, paru en 2016. Mais j’ai senti la nécessité d’y revenir de manière plus intime. Dans Nous le lac, j’ai mis au jour des pans plutôt trash (mais non dénués de bonheurs pour autant) d’une mémoire modulée par la difficulté à simplement aspirer à l’existence et par la fatigue qui en découle.
P. B. – Le lac miroir est aussi un miroir intérieur.
E. T. – Oui, le lac est un miroir, parce qu’il est, justement, intériorisé. C’est dans ce paysage-là que l’écriture a plongé. Or les reflets que j’y ai trouvés n’ont pu m’apparaître que dans la mesure où j’ai tendu l’oreille à la langue maternelle. Tout passe par l’imaginaire de cette langue du lac de mon enfance qui a réveillé la mémoire du corps, a libéré les émotions qui structurent les poèmes.
P. B. – Les mots, une corde invisible. Ils « ont la tendre dureté du bois ».
E. T. – Il y a un « nous » de la langue maternelle, c’est-à-dire d’une expression vernaculaire qui est indissociable d’une manière d’être dans l’espace et le temps. Cette expression, qui donne corps à l’appartenance, elle a été irrémédiablement perdue au profit de la langue normée, que Pasolini appelait la langue du privilège (visant à l’intégration). Je n’ai pas cherché à retranscrire ou reconstruire cette langue des origines, seulement à en invoquer le souvenir. Elle demeure lointaine, quoiqu’en palimpseste dans les poèmes. Par exemple, lorsque j’écris que les enfants sont « débarqués des cendriers », c’est pour faire entendre les voix qui leur intimaient de « débarquer de d’la », alors qu’ils avaient été surpris à imiter les adultes en jouant avec des cendriers. Bref, plutôt que de traduire une oralité, je me suis exercée à saisir les images suscitées par son rappel.
P. B. – Il y a un glaive, une guerre.
E. T. – La guerre est celle des sexes dont j’ai voulu faire une genèse personnelle. Et je me suis rendue compte à l’écriture que le conflit tirait son origine du refus du legs féminin dont la mère est la représentante. C’est donc une guerre du sexe féminin avec lui-même qui prend place dès l’enfance. Plusieurs poèmes portent sur ce conflit intérieur et sur sa projection dans les relations homme-femme, dans le « nous » du couple. Enfin, suivant la chronologie de l’évolution d’une vie qui articule le recueil, j’espère avoir réussi à recréer une certaine fluidité au sein de la conscience qui s’abandonne, finalement, aux liens d’amitiés, tous sexes confondus, à travers la littérature.
P. B. – Enfin, Vallejo : « Pourquoi la corde, alors, si l’air est si simple »?
E. T. – Les vers de poètes masculins tels Jacques Brault, César Vallejo et Álvaro Mutis sont convoqués dans les dernières parties du recueil, où se retissent les liens homme-femme, dans l’entrelacs des voix. Ils viennent après ceux de Josée Yvon, Carole David, Louise Dupré et Denise Desautels, jusque-là intégrés aux miens comme un legs assumé en filigrane.
Les mots de César Vallejo que tu cites évoquent une déprise, en guise d’épilogue. Dans la dernière section du texte, mes propres vers répondent à cette invitation de Vallejo, en s’affranchissant de leur linéarité pour se distendre de façon verticale. L’air s’offre comme seul possible viable. Le monde pourra y retrouver sa respiration, ainsi que tous les lacs dont dépend notre survie. D’autres images viendront de lui, comme je l’espère. Maintenant que j’ai tiré sur la corde des origines pour la faire vibrer le temps d’un livre, pourquoi ne pas la laisser battre au vent? C’est aussi une manière d’envisager l’avenir face à son incertitude, avec plus d’humilité.