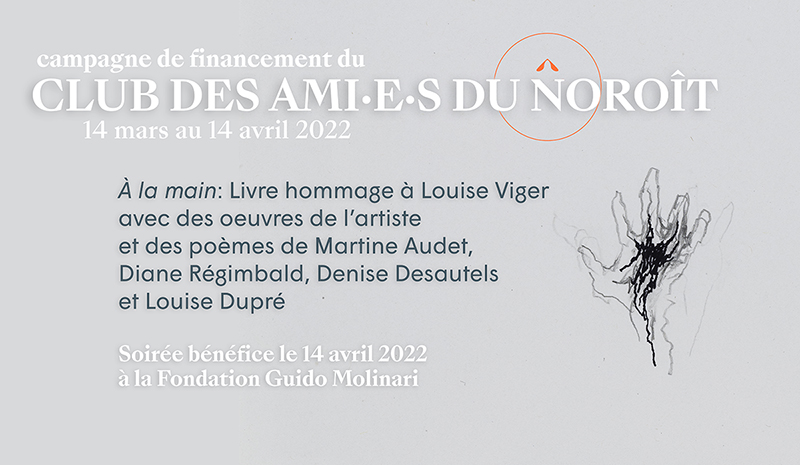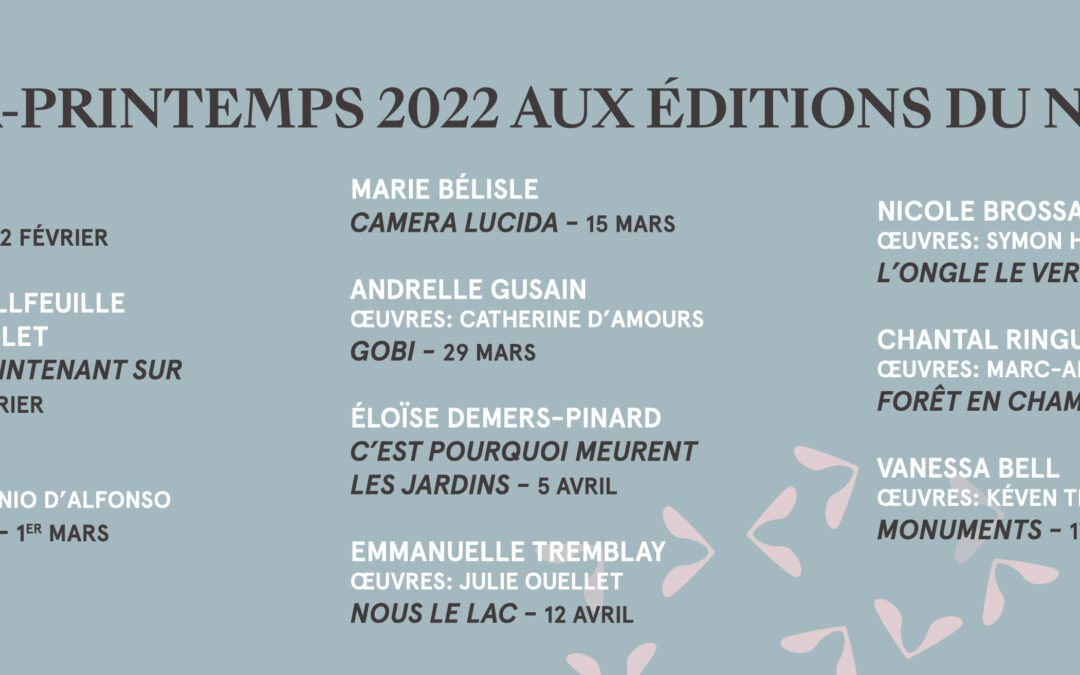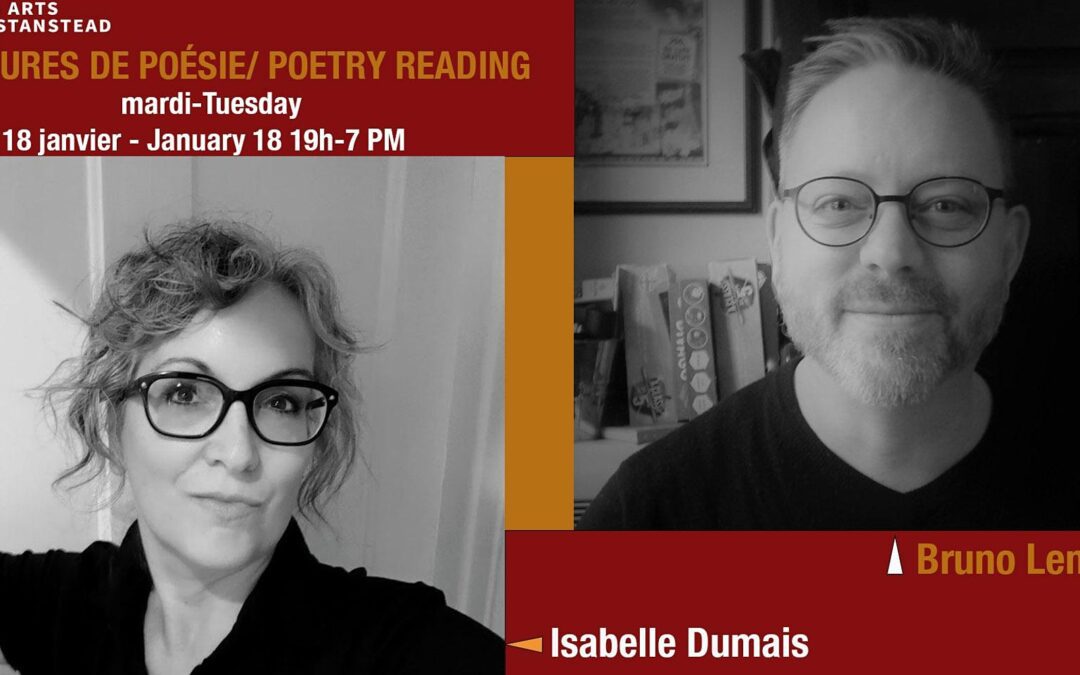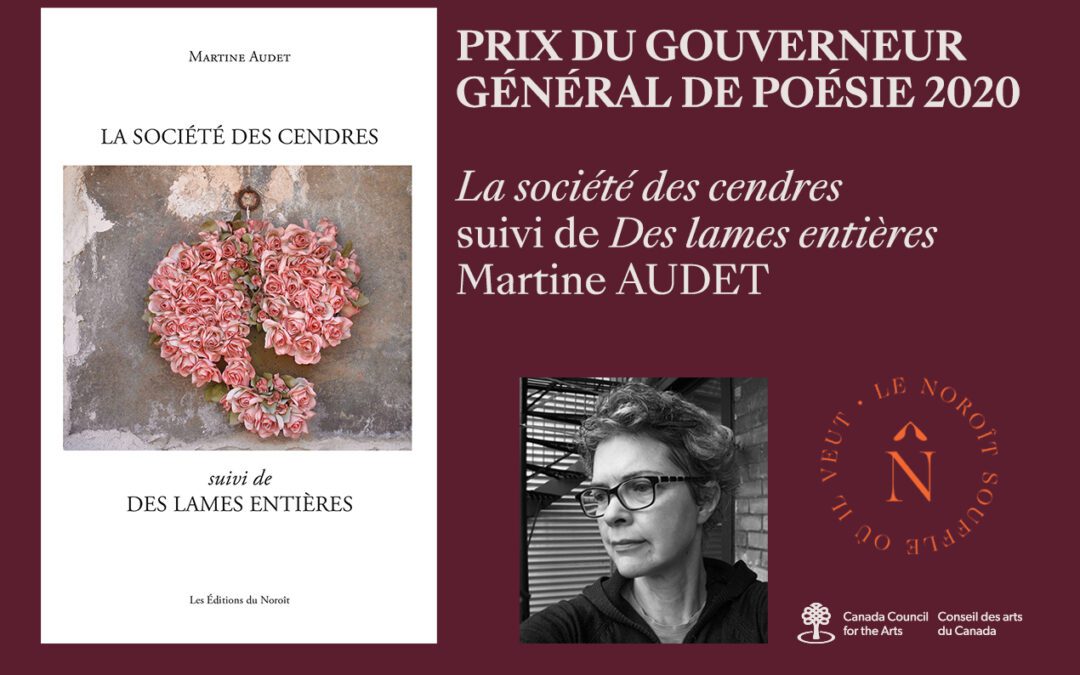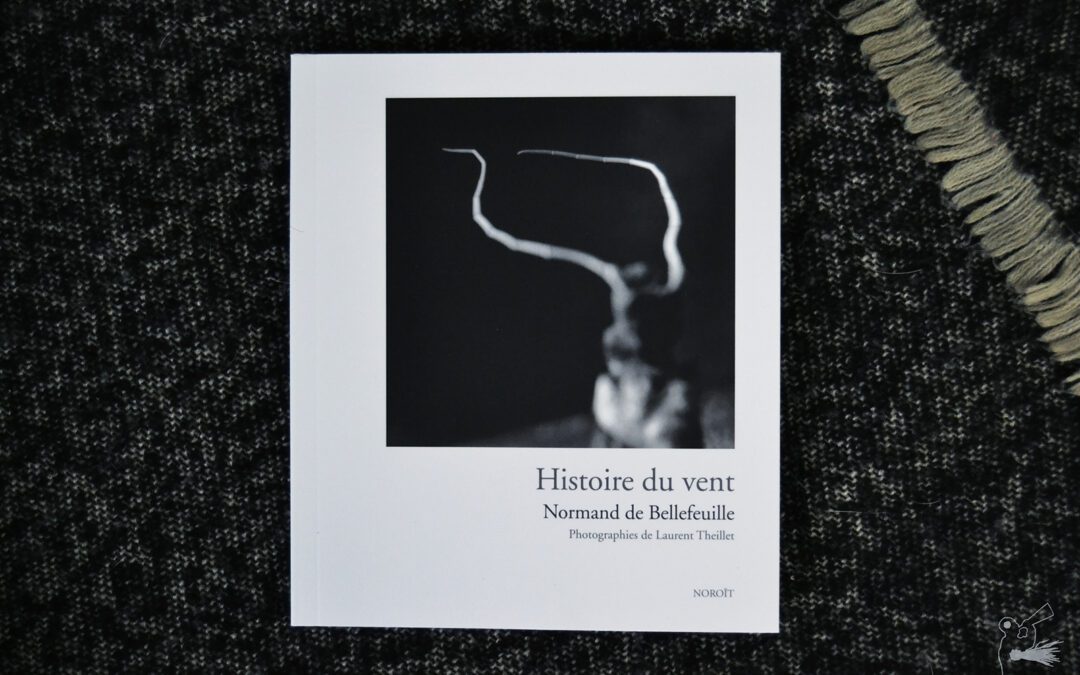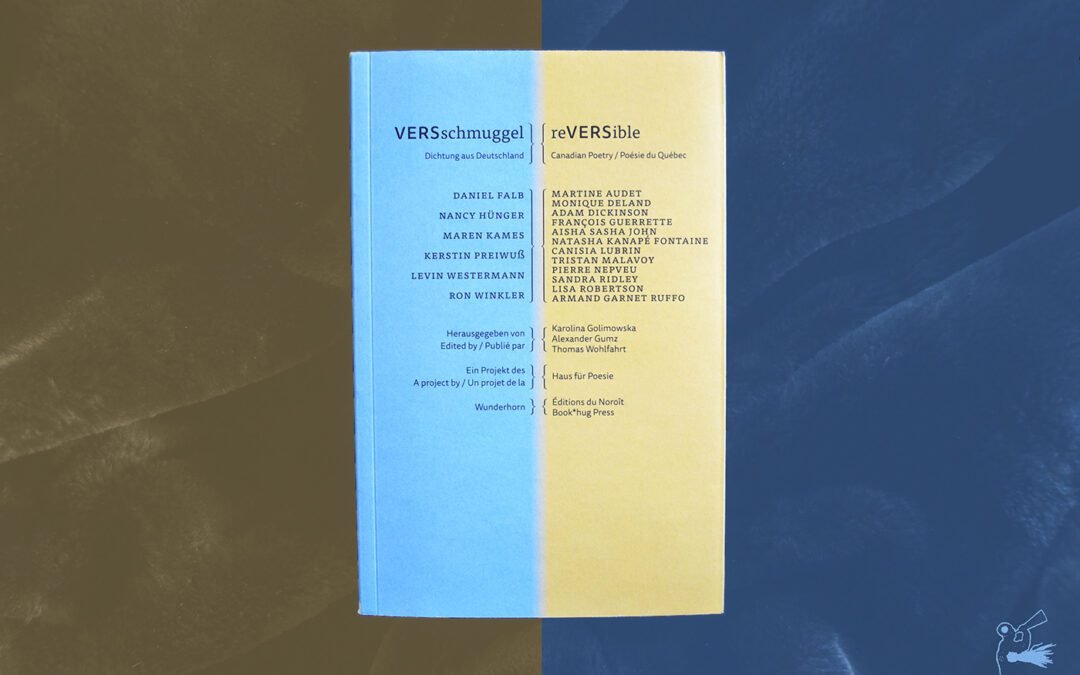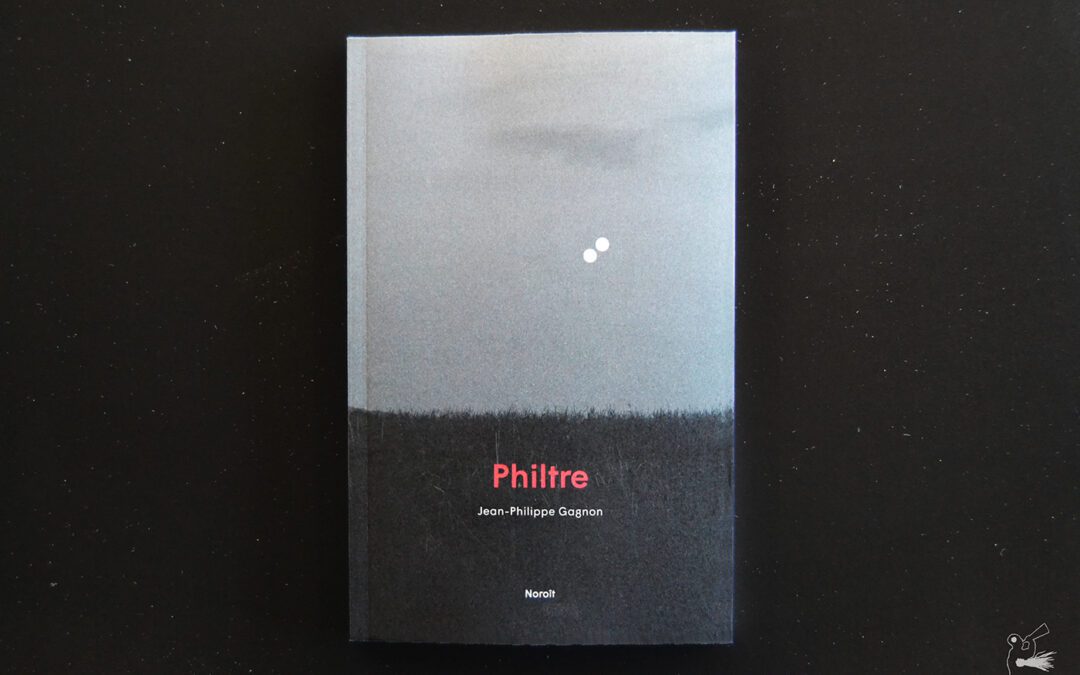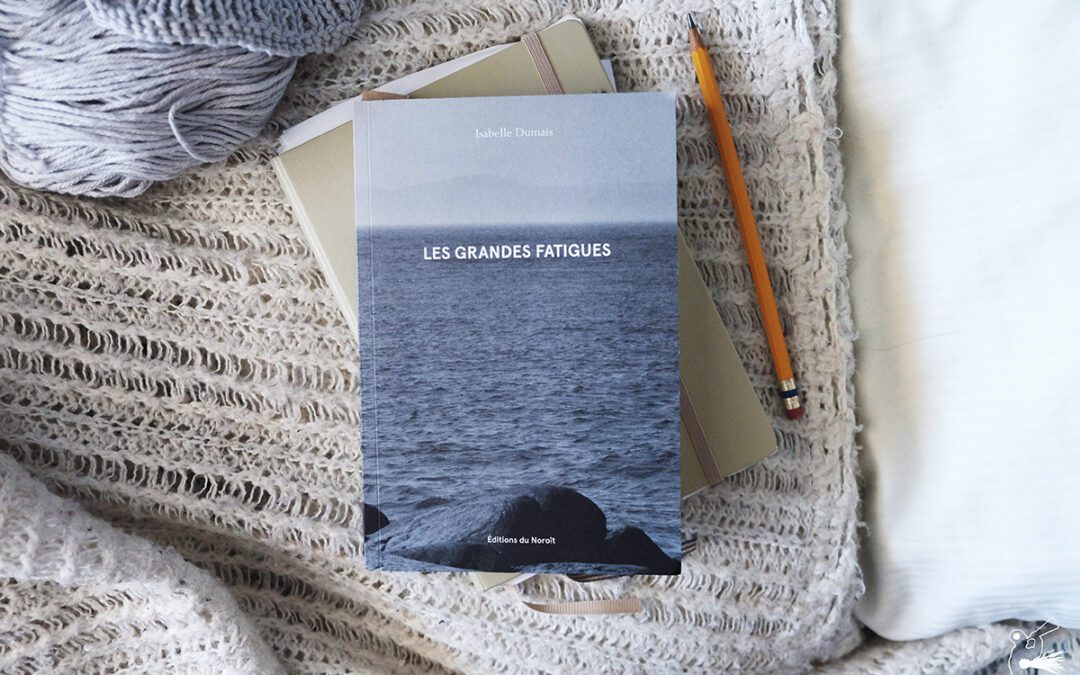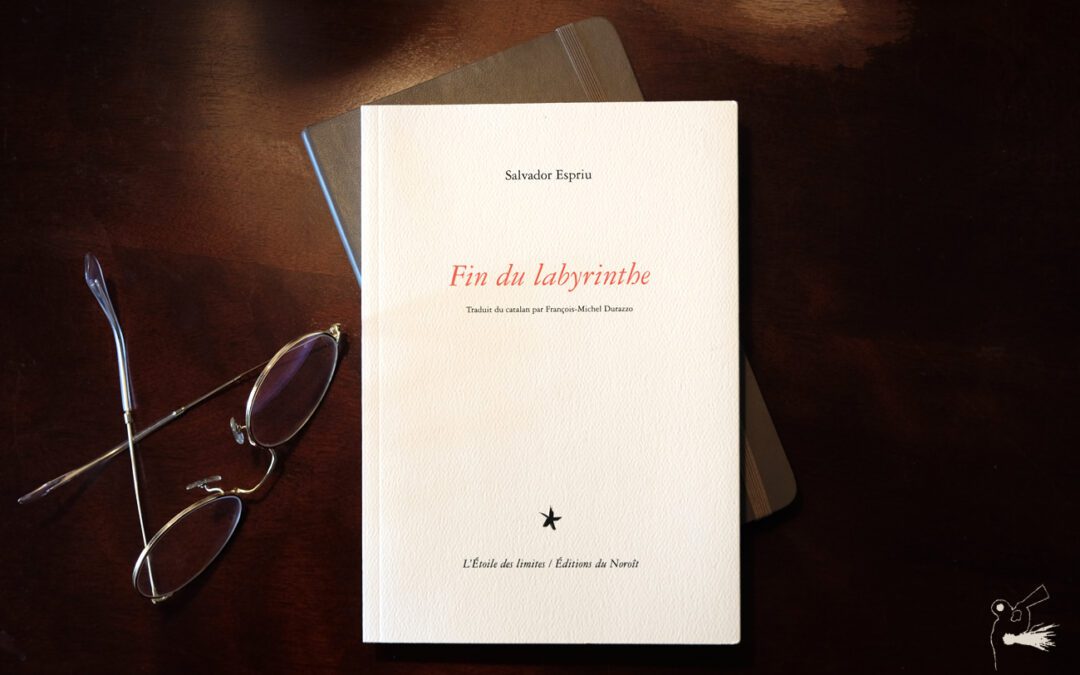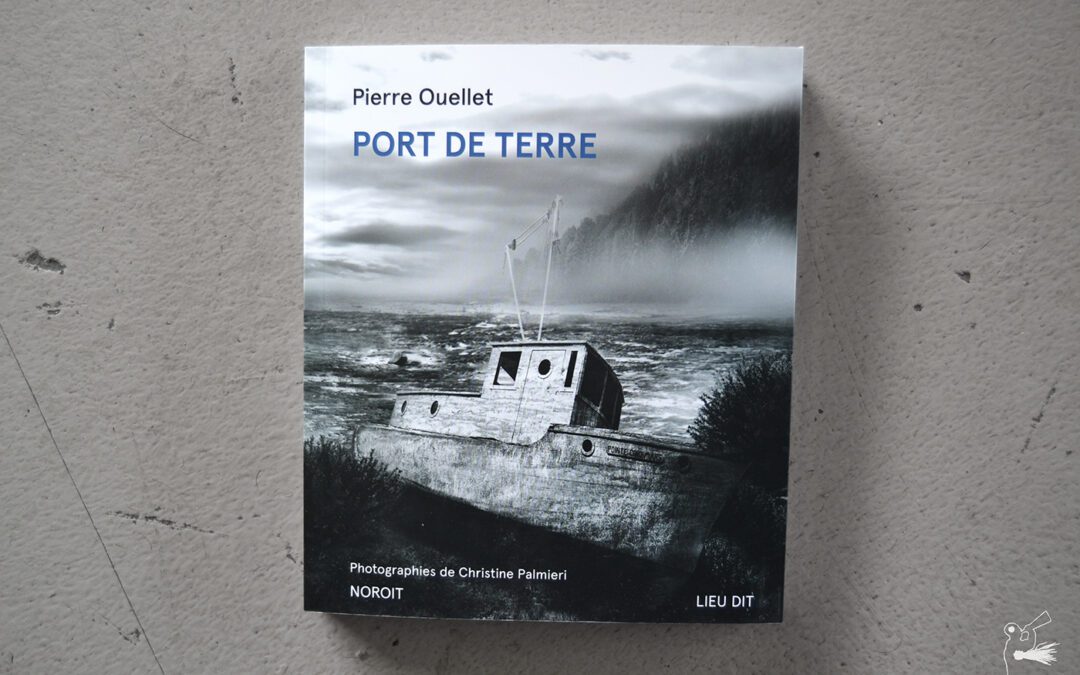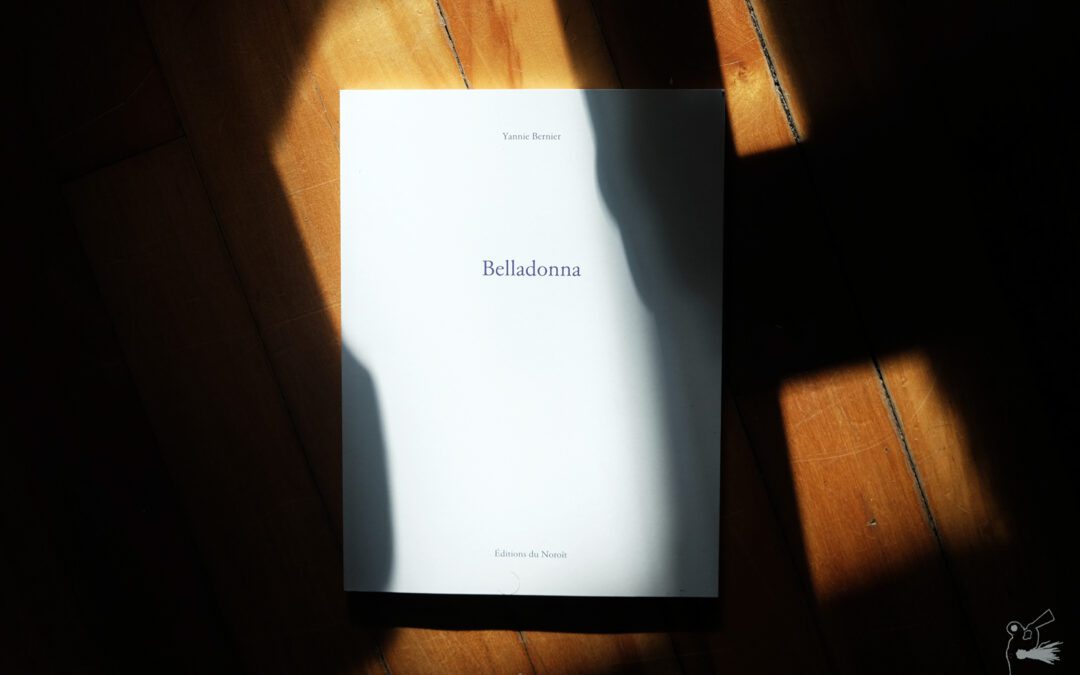Conversation entre Paul Bélanger et Élise Turcotte autour de son recueil de poésie À mon retour (2022)
P. B. – Élise, tu as dit que À mon retour était ton livre le plus libre, en ceci que tu ne t’es pas occupée de la structure du livre, que tu l’as laissée se trouver elle-même.
É. T. – Oui, la structure s’est vraiment dévoilée d’elle-même, même si je savais déjà que l’arbre viendrait parler à la fin. Pas comme une réponse, mais comme ce qui reste après la fin d’une conversation dans laquelle est venue se loger une accalmie. Par ailleurs, j’avais probablement en tête l’ensemble, sans l’énoncer, par instinct, car je travaille ainsi depuis toujours.
Pour répondre de façon plus concrète, je ne pensais pas trop au recueil, mais à la page, comme ouverture, qu’elle accepte chaque poème même s’il y a des ruptures de ton, du sens qui s’effrite et retourne vers la chute. C’est comme un geste large qui voudrait emporter toutes les images. D’où le sentiment de liberté. Je choisis aussi, de plus en plus, parfois de travailler sans discipline, sans cadre. Aussi, tout le recueil a un peu été écrit comme une sorte d’éphémérides, dans le sens astronomique du terme. Je mets des éclats du jour sur la table. C’est une simplicité dont j’avais envie par mes deux précédents recueils qui avaient un rythme proche parfois du manifeste. Ici, on est plus dans la collection, l’assemblage, que dans l’urgence, et je voulais surtout donner toute la place aux images.
P. B. – La poésie retranscrit ce qui s’effrite…
É. T. – C’est plus une sorte de saisie, mais sans jamais vouloir désamorcer l’effritement. La disparition fait partie de mes obsessions. Je n’essaie pas de sauver les objets du naufrage, mais de les photographier en pleine chute, ou en errance dans un monde nouveau.
P. B. – Comment habiter au-dessus des ruines avec la conscience de sa fin?
É. T. – J’habite, comme tout le monde, dans les ruines. J’en fais des images. Chaque jour, je photographie des objets, des morceaux de vie, je lis les journaux, j’analyse les discours, et ces mots et images entrent ensuite dans mes poèmes qui en sont la cristallisation. La conscience de la fin est une vraie angoisse. Physique. C’est peut-être pourquoi j’ai besoin d’accumuler des preuves de vie sur terre.
P. B. – Le poème est refuge et sans doute aussi refus de ce qui nous est donné comme une évidence.
É. T. – Je me réfugie sans doute dans la matérialité de la langue, dans sa puissance de métamorphose. Mais c’est un refuge qui reste une cible exposée parce que découlant d’une sorte d’observation radicale de la réalité. En cela, aussi, et surtout, c’est un refus, une esthétique de combat.
P. B. – Les animaux, la nature et ton troupeau de mots pour t’énoncer dans ton arbre souvenir.
É. T. – Je ne pense pas m’énoncer, pas tout à fait, j’ai plutôt l’impression de laisser les choses et les animaux se manifester, pour ce qu’ils sont, présences, texture, esprits, mystères. Mais bien sûr, c’est à travers mon langage qui est travaillé comme une matière. Si quelque chose apparaît, c’est l’habitat, le mien, qui est l’écriture elle-même.
P. B. – Maintenir le verbe en vie
dans ta chute
É. T. – C’est l’écriture, encore une fois.
P. B. – « toute ombre est amour
l’arbre dit »
É. T. – Oui, car c’est dans l’ombre, en dehors d’une sorte de clarté aveuglante de l’actualité que les choses les plus difficiles à aimer se trouvent. Les recueillir, les éclairer autrement, dans une langue imparfaite, mais brûlante, c’est une forme d’amour. Chercher ce qui manque, ce que la réalité ne donne pas d’elle-même, faire parler les fragments sans les embrigader dans un tout, c’est aussi un engagement. Ce mot, d’ailleurs, amour, je ne l’utilise pas si souvent. Il me semblait ici presque téméraire. J’aime bien vider le sens de certains mots et les remplir avec une nouvelle matière.
Je repense à Pouvoir du Noir, une série de poèmes de Roland Giguère qui m’ont marquée jeune et que je relis à l’instant :
Mais le noir n’est pas bourreau, au contraire, le noir est broyé et de sa poussière naissent ces formes, ces signes, ces accents que nous pressentions et qui tout è coup surgissent des profondeurs au premier appel, comme une faune sauvage déferle dans un plaine de neige.
P. B. – Un souvenir voyant dans une robe jaune
ces associations créent des surprises. Du lien entre surprise et allégorie
mais comment travaillent-elles et comment te révèlent-elles?
É. T. – Un fil rouge traverse ces poèmes, par exemple : celui du feu qui à la fois ravage tout et rallume des souvenirs, images, qu’on croyait jusque-là séparées, esseulées. Les relier, c’est comme créer les conditions d’une survie, d’une résistance. Il y a aussi l’enfant disparu.
Cela renvoie à des événements précis qui se sont imprimés dans la mémoire de ma langue. Des étincelles ressurgissent et je les laisse vivre. La robe jaune soufre, les animaux malades, le corps glacé de l’enfant disparu, les fusillades en Amérique, etc.
P. B. – On entend l’espace
l’arbre dit
« ne pense plus/ à classifier les espèces »
É. T. – Ce n’est plus nécessaire puisque nous sommes multiples, et nombreux à ne plus vouloir se soumettre.
C’est aussi au passage une critique d’une société où nommer le nom de la maladie est plus important que soigner un être humain.
P. B. – La dernière suite se présente comme un dialogue
avec les choses
avec soi
É. T. – Je l’ai beaucoup réfléchie cette suite. Je voyais ceci : après la fin du monde, la narratrice se retrouve dans le souterrain de la ville, à côté d’un arbre dont les branches continuent à pousser à l’horizontale. C’est l’arbre de son ancienne vie. Viennent les souvenirs de la catastrophe, le chien qui regarde tout, l’enseignement de la résistance.
P. B. – Comment encore poursuivre
en un combat à l’issue certaine
É. T. – Je ne sais pas. C’est le sens du combat, j’imagine. Et continuer est aussi une façon de conjurer la mort.
P. B. – Toujours une révolte en toile de fond
É. T. – Bien sûr. La révolte est la seule posture possible. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas aimer, car toute ombre est amour, n’est-ce pas ?
P. B. – Il y a des êtres (arbres chevaux chien clé)
« qui parlent la langue du ciel »
É. T. – J’aimerais le formuler ainsi, comme Silvia Baron Supervielle ;
« Je poursuis le trajet du chant. (…) Le chant, qui passe dans l’arrière-pays du livre, donne à l’écriture ce que la lumière donne à la peinture : il est plus intense que le sujet ou que le style. »
P. B. – Parfois on dirait un rêve faisant du fétichisme des choses ou des animaux
comme des idoles ou des icônes qui tombent en toi et dans la page (avec Baudelaire)
É. T. – Je ne pourrais pas mieux le formuler ! Elles tombent en moi, mais aussi de moi et du monde autour, comme des écorces !