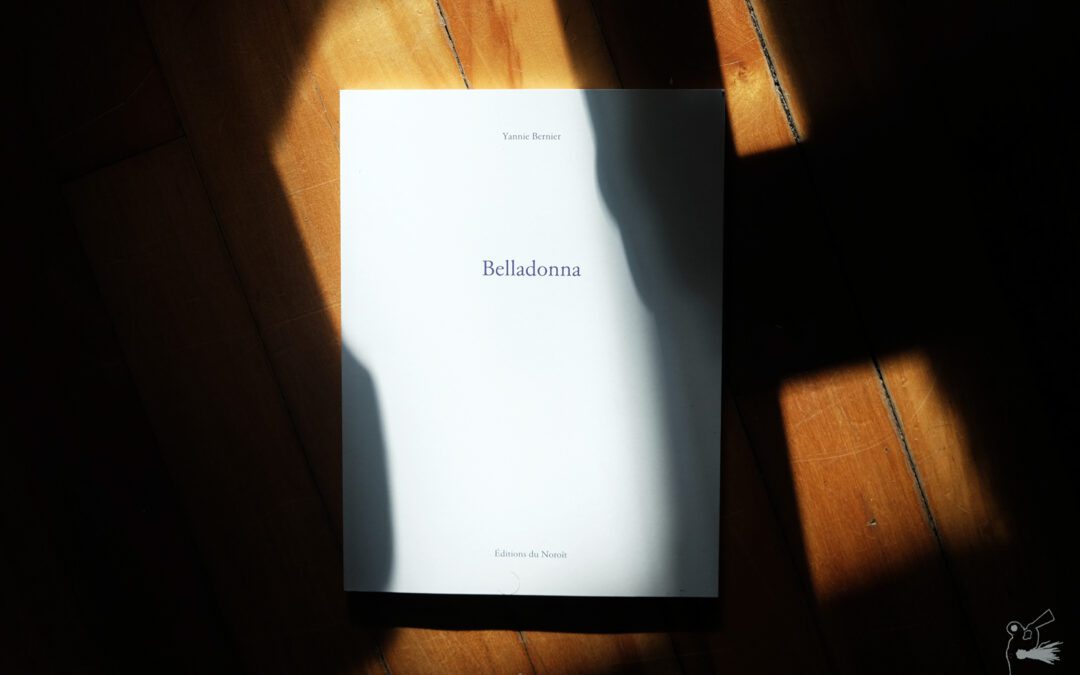Conversation entre Paul Bélanger et Monique Deland autour de son recueil de poésie Noir de suie, Poèmes d’atelier (2023).
Paul Bélanger – Le titre de ton livre, Noir de suie, suggère une évocation double : une couleur et un état.
Monique Deland – Oui, c’est vrai que le nom de la couleur noir de suie renvoie aussi à un état : le fait d’être couvert de suie. D’être noirci par la suie. Donc d’être passé par le feu, d’être passé au feu. En peinture, c’est exactement ça, puisque la couleur noir de suie (ou lamp black, en anglais) est littéralement produite par le feu. Traditionnellement, on faisait brûler de l’huile dans une lampe à l’huile, et on récoltait la suie accumulée sur le bord du verre à l’aide d’une plume d’oie. La recette est encore en usage aujourd’hui, et avec cette couleur générée par le feu – qui peut aussi donner de l’encre (de Chine ou sumi japonaise) –, on peut écrire, dessiner ou peindre.
Donc, oui, tu as raison, le titre est porteur d’une double référence. Il renvoie à la vitalité créatrice vécue dans l’atelier quand on utilise la couleur noir de suie, mais il renvoie aussi à la violence destructrice du feu qui curieusement permet la création, à travers la fabrication des matériaux utilisés. C’est un très beau paradoxe, je trouve !
Et le paradoxe tient tout entier dans le seul nom de cette couleur, qui est très lumineux au bout du compte. Surtout qu’il met en abîme le processus créatif lui-même, dans la mesure où l’acte de création recycle nos expériences de vie – en les faisant passer par le feu de la transformation langagière – dans le but d’en faire une œuvre d’art. Réel dans un cas et symbolique dans l’autre, le feu agit un peu comme un agent catalyseur. Il tient un rôle central dans la fabrication de la couleur noir de suie, et aussi dans la métabolisation de nos histoires personnelles qui sont relancées dans (et par) le processus d’écriture.
… En plus, je l’ai vu seulement après avoir fini le livre, mais le feu est partout dans les poèmes ! Alors, le nom de la couleur noir de suie était tout indiqué pour raccorder les bouts, si on veut. C’est comme ça que Noir de suie est venu s’ajouter à mon titre de travail, qui était tout simplement Poèmes d’atelier au départ.
P.B. – C’est la première fois qu’un de tes livres de poésie propose des images pour accompagner les poèmes. Pourquoi ?
M.D. – Dans ma vie de tous les jours, je me promène entre la poésie et la peinture. J’aime les deux. Mais j’ai pas du tout le même rapport aux deux formes d’art. Quand je fais de la peinture ou du dessin – même si je me contente de petits formats –, ça me demande vraiment beaucoup d’énergie physique, alors que j’en ai pas tant que ça ! Alors, quand j’arrive au milieu de la journée et que j’ai plus de jus pour la peinture, je m’arrête et je m’assois. Je rentre dans ma tanière psychique, et je me reconnecte à mon énergie mentale qui, elle, semble infinie. Toujours fraîche et toujours dispo. M’assoir pour écrire de la poésie me défatigue le corps. Ça recharge ma batterie physique. Mais, c’est surtout sur le plan de la création que cette alternance entre peinture et poésie est intéressante, parce qu’elle me permet de changer de bord de rue dans ma tête. Ça me donne accès à d’autres aspects de ma vie intérieure. C’est comme si je m’habitais différemment, ou comme si je me découvrais autrement. Au cumul, à force de me promener entre les deux, je finis par faire le tour complet du jardin… ou du cimetière !
P.B. – Tu dis : « La langue est d’une précision redoutable. »
M.D. – Oui. Et je le vis souvent comme une tyrannie. Ma langue endosse la clarté ou la justesse comme un poids très lourd à porter. Je suis dans la langue du poème en complète transparence, en totale vulnérabilité. Et, là aussi un peu comme avec la peinture qui m’épuise physiquement –, toute cette franchise et toute cette précision peuvent être assez éprouvantes pour les nerfs. On est dans nos poèmes comme au miroir, et se voir dans cette toute flagrante exposition de soi tout à coup est pas toujours de tout repos. Quand ça devient trop dur, il faut se remettre au calme.
À ce moment-là, le circuit se fait dans l’autre sens : je ferme la maison de l’écriture, et j’entre dans l’atelier, où je peux prendre une grande bouffée d’air neuf. J’arrête de penser, et ça apaise les émotions en jeu dans le poème. Je me mets sur la glace… Jusqu’au prochain appel du poème ! Ce qui est bien dans cette alternance, c’est que j’ai pas besoin d’arrêter le mouvement créateur pour autant. J’ai juste à le diriger différemment, en utilisant d’autres outils.
À mon sens, il y a aussi un grand avantage à passer de la poésie à la peinture. Parce que si, du côté de la poésie, j’ai l’impression de parler (trop ?) précisément, la plupart de mes tableaux, eux, sont abstraits. Alors, ça déplace le seuil de tolérance. Ma peinture parle beaucoup moins franc que mes poèmes, et le flou créatif auquel consent ma pratique de la peinture m’est très salutaire à certains moments.
Il m’arrive de penser que la lecture de mon livre provoque peut-être le même effet… On y passe des poèmes qui sont clairs – et même explicites – à des images qui laissent davantage place à l’interprétation. Ça crée une pause mentale. Parce qu’il se promène entre les mots et les images (comme moi au moment de sa création), le livre finit par faire lui aussi le tour du jardin. Alors, l’objet-livre témoigne du double processus qui l’a fait naître : poétique et pictural. Je pense que c’était le bon livre pour faire ça, surtout que le livre porte précisément sur le processus de création. Je suis ravie que mes éditrices aient accepté de me suivre dans ce qui me semblait quasiment une extravagance. Pour moi, au départ, c’était un peu un projet fou – j’avais très rarement montré mes tableaux jusqu’ici. Mais grâce à Charlotte et à Mélissa, le chat est sorti de son sac ! Et c’est devenu un vrai livre ! Je leur suis vraiment reconnaissante…
P.B. – C’est cette double approche qui est en jeu, quand tu dis que « l’art est une affaire d’empilement des sédiments » ? C’est la peinture et la poésie qui se superposent ?
M.D. – Non, pas exactement. Pour moi, ce qui se superpose dans l’acte créateur – peu importe que ce soit en peinture ou en poésie, d’ailleurs –, c’est toutes nos expériences de vie. Qui passent, oui, mais qui laissent des traces en nous. Des sédiments. Vestiges d’anciens événements. Des vies passées, mais pas disparues. L’empilement, c’est ce qui fait qu’on est comme on est, à différentes époques. Et je pense que la création se nourrit de cet étagement-là. En particulier de nos étages inférieurs, de ce qui est enfoui en nous et qui demeure fondateur de ce qu’on est, précisément parce que c’est enfoui.
P.B. – Tes poèmes parlent justement de « la fille enfouie ». Et tu dis : « je reste une avalée de la terre ».
Est-ce la même chose ?
M.D. – Pas mal, oui. La fille enfouie, c’est la fille meurtrie qui s’est creusé un sillon dans la terre, en espérant pouvoir être à l’abri des dangers qui fusent à la surface du monde. Ça veut pas dire que ça marche dans la vraie vie, mais dans l’écriture c’est un bon terreau à exploiter !
P.B. – Et peindre et écrire sortent la fille enfouie d’elle-même ?
M.D. – Hum… Dur à dire. Bien entendu, l’œuvre expose au-dehors les intérieurs de la fille enfouie. Mais c’est pas parce que le poème fait la lumière sur les expériences de l’ombre que la fille est remise à neuf. Une copie ou un double des expériences qui constituent le terreau primordial de l’écriture passe au-dehors, c’est vrai. Mais la fille, elle, elle reste là… Avec l’original ! Ce qui peut changer parfois, c’est l’épaisseur de l’étagement. Son poids. Après la mise en forme – l’écriture d’un poème ou la réalisation d’une peinture –, ça peut diminuer un peu. Sur le coup, en tout cas !
P.B. – Tu parles de « fille enfouie » et pourtant ton livre fait plusieurs références au cosmos…
M.D. – Hahaha ! Une affaire de polarités, j’imagine ! C’est vrai que j’éprouve une grande fascination pour le cosmos. Pour moi, le cosmos, c’est comme une illustration de tous les mystères de la vie. De tout le côté impalpable de notre univers : les gaz, les trous noirs, l’absence de gravité, l’absence de lumière, et le reste. On parle ici de 95,1% de notre monde, qui sont faits d’énergie sombre, totalement inconnaissable ! C’est quand même quelque chose ! Ça me hante depuis toujours, et ça se retrouve dans chacun de mes livres tellement c’est prégnant.
Mais l’autre pôle du continuum me rattrape, parce que je suis tout autant fascinée par la matière : le ras des pâquerettes. Les textures, les couleurs, la concrétude et la physique du monde visible. Ça me vient de mon père qui était scientifique, prof de géologie à Concordia. Il est mort alors que j’étais encore jeune, mais il a eu le temps de former mon esprit de façon durable. Je devais avoir à peine six ans quand il a commencé à m’amener visiter toutes sortes de lieux qui pouvaient présenter un intérêt scientifique. Le Planétarium (qui s’appelait Le Planétarium Dow, à l’époque), le Musée Redpath de l’Université McGill et le Jardin botanique, entre autres. Puis, durant les étés, on prenait la route. On en a fait du millage ! On est allés voir les mines de quartz du Mont-Tremblant, celles d’or et de cuivre de Rouyn-Noranda, et aussi la côte gaspésienne avec ses traces d’érosion et… l’étagement de ses sédiments, justement ! Ça faisait des œuvres d’art multicolores gigantesques exposées à flanc de montagnes. À couper le souffle ! On est allés voir chacun des Grands Lacs, aussi grands que des océans, et les chutes Niagara qui grondaient si fort qu’il fallait que je me bouche les oreilles avec les doigts. Mais la vibration entrait par la porte d’en arrière, et venait me résonner dans le ventre comme les tambours d’une parade géante. J’oublierai jamais ça.
Mon père, lui, était un fan fini des grottes de sable de la Nouvelle-Angleterre et de l’État de New York. On y retournait régulièrement. C’est vrai que c’était d’une grande beauté. Quasiment magique, tellement c’était mystérieux. Stalactites, stalagmites, calcaire, dépôts de sel, mon père m’expliquait tout ça dans le détail, comme si j’étais une de ses étudiantes universitaires. La formation des montagnes, celle des lacs, la composition chimique des minerais, la structure interne de la Terre, son manteau, son noyau, ses volcans, les fonds marins, les failles océaniques, les marées, l’attraction lunaire, la croûte terrestre, ses transformations au fil des ères géologiques, sa surface visible, ses profondeurs invisibles, la place de notre planète dans l’infini, les orbites, l’attraction terrestre, la gravité, les champs magnétiques, les pôles magnétiques, absolument tout y passait ! On a même fait des expéditions pour aller détecter les veines d’eau sous la terre, avec des baguettes de sourciers ! Mon père était scientifique, mais il reconnaissait sans problème les limites de la science. Ça faisait de lui un homme très ouvert. Il avait la même curiosité devant l’inexplicable et les grands mystères de la vie que devant la matière. Ça m’a influencée, ça aussi.
Évidemment, ses explications savantes me passaient en grande partie au-dessus de la tête, toute petite fille que j’étais. Mais je pense que ça a quand même contribué à développer en moi ce qu’on appelle l’esprit scientifique. Quelque chose qui a trait à une curiosité pour le monde, au désir de le connaître et de le comprendre. Peut-être à la méthode de la démarche ou à une rigueur dans le raisonnement, aussi. En tout cas, le fait de pouvoir observer autant de phénomènes naturels dès mon plus jeune âge a certainement jeté les bases de mon amour pour les matières du monde et pour ses beautés. Et ça se retrouve dans mes poèmes, forcément. Je continue de remercier mon père pour tout ce qu’il m’a transmis, et pour son sens de l’émerveillement dont j’ai hérité. C’est un cadeau formidable, et j’en apprécie la valeur chaque jour de ma vie… Après tout, ça prend un minimum d’émerveillement pour faire de la peinture et de la poésie !
P.B. – D’où la section qui porte sur la chimie des couleurs : « Des taches sur les doigts ».
M.D. – Oui, c’est ça. C’est sûr que, de manière générale pour une artiste visuelle, c’est primordial de bien connaître les matériaux qu’elle utilise dans son travail, parce que, grâce à ça, elle peut prévoir un peu leur comportement au moment de créer. Mais, personnellement, je trouve ça intéressant aussi de connaître l’origine des pigments. Pas tellement les pigments synthétiques (plus modernes), mais les pigments naturels surtout, qui proviennent des matières organiques ou minérales produites par la Terre. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait me sentir en phase avec les éléments. Ça m’apaise. Et, par de drôles de chemins, cette idée-là m’aide à faire confiance au processus de création…
P.B. – Dans Noir de suie, tu utilises l’anglais plus que dans tes livres précédents. Pourquoi ?
M.D. – Oui, tu as raison. Il y a davantage d’anglais dans Noir de suie que dans mes livres précédents, même s’ils en avaient déjà quand même un peu. Il faut dire que l’anglais est pas la seule autre langue que le français dans le livre. Il y a de l’italien, de l’espagnol, de l’allemand, du japonais et du latin, entre autres. Il y a même quelques onomatopées. Les sons aussi, c’est un langage ! Pourquoi s’en passer ? C’est une langue parallèle, un peu comme la peinture par rapport à l’écriture. Personnellement, je trouve que faire se rencontrer différentes façons de communiquer dans un même ouvrage permet de multiplier les façons d’entrer en résonance avec le contenu. C’est une façon globale d’être au monde, il me semble, et de l’embrasser de manière intégrale, en ramenant toutes ses composantes sur le même plan.
J’ai d’ailleurs refusé que les mots qui appartiennent à une autre langue que le français soient mis en italique, dans le texte. C’est une question de vision. Pour moi, à partir du moment où j’établis les mots qui vont devenir ceux du poème, c’est les mots d’une même bouche qui les fait siens. J’endosse tous ces mots-là de ma même façon, sans discrimination et sans égard à leur origine. Le fait que les mots étrangers doivent avoir un statut typographique différent de celui qu’ont les mots français relève d’une convention. Le poème peut certainement se permettre de bousculer quelques conventions. À la limite, je dirais que, dans mon esprit, le choix de la langue qu’on utilise est secondaire par rapport à ce qu’on veut que cette langue fasse pour nous dans le poème. Quand je peins, je suis ambidextre. Et je pense que je peux faire la même chose quand j’écris de la poésie. C’est-à-dire que je peux parler de la gauche ou de la droite, selon les besoins du texte. Accorder au poème la possibilité de prendre forme à travers plusieurs langages différents, c’est lui donner le droit de s’inventer une langue multicolore qui donne à voir tout l’arc-en-ciel de l’expressivité. L’idée me plaît.
Mais, au-delà de ça, c’est vrai qu’il y a une raison. J’avoue que j’associe la langue anglaise à quelque chose de particulier. Dans mon esprit, l’anglais est souvent porteur d’une violence qui trouve pas son équivalent en français. Je sais que quand j’arrive au bout de ce que j’ai pu vouloir dire en français et qu’il me manque encore un degré d’intensité, mon aire de Broca switche spontanément à l’anglais. Mais au-delà de ça – qui est une impression personnelle –, je pense qu’il y a aussi quelque chose d’objectif qui va dans le même sens. Il y a une grosse différence entre dire « You can go fuck yourself » et dire « Tu peux aller te faire foutre ». C’est sonore, souvent… Il y a beaucoup de sonorités dures, en anglais. Serves the purpose, comme on dit ! Alors, quand je veux enfoncer le clou ou encore donner un tour de vis à une rudesse pas assez manifeste à mon goût, la dureté de la langue anglaise vient à la rescousse, comme un outil idéal. La poésie sait se faire généreuse !
P.B. – À quelques exceptions près, les œuvres visuelles présentées dans ton livre sont des aquarelles.
M.D. – Oui, l’aquarelle est un médium assez récent pour moi. À peu près trois ans, seulement. Et j’aime beaucoup ça. Je trouve qu’il y a une belle humilité à l’aquarelle. C’est un peu comme dessiner au crayon de graphite. C’est minimal, léger, transparent, souple et très versatile. Comme l’encre sumi japonaise, l’aquarelle est le médium des pauvres. Sans prétention par rapport à l’huile. Ou même à l’acrylique. La peinture à l’eau, c’est aussi le médium des enfants ! Bien sûr, dans l’histoire de l’art, l’aquarelle a été utilisée par les grands maîtres, mais c’était souvent rien que pour faire un petit croquis à la va-vite, faute de mieux. Avec l’aquarelle, j’ai l’impression de revenir au jeu de base, dans l’esprit du débutant. Je réapprends les bases, sur la base d’aucune base. C’est frais et reposant. Je m’attends à rien et j’accepte d’être surprise par le médium. Par ses caprices, ses exigences, son rythme. Et puis – détail non négligeable –, on fait l’aquarelle sur du papier. Le même support que l’écriture ! Contrairement à la toile qui est plus luxueuse, le papier est une matière du quotidien. C’est sobre et ordinaire, oui, mais aussi c’est doux, poreux et cotonneux. Accueillant même, je dirais. Alors, entre peindre sur du papier et écrire sur du papier, il y a une parenté sympathique, je trouve… On change de bord de rue, mais on reste dans la même ville !