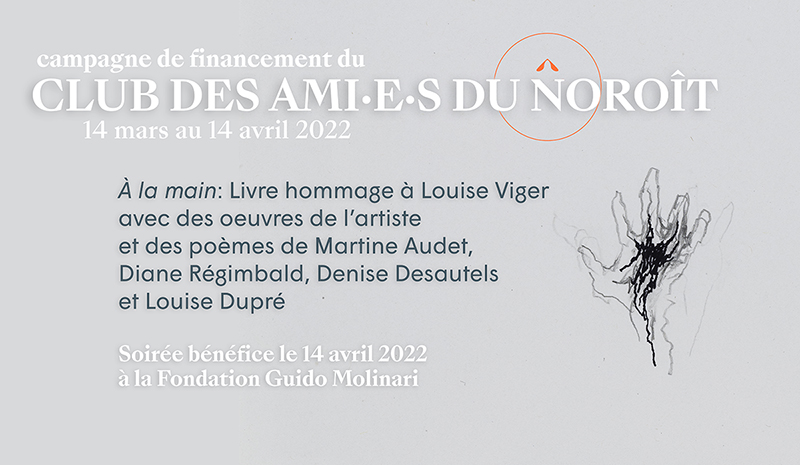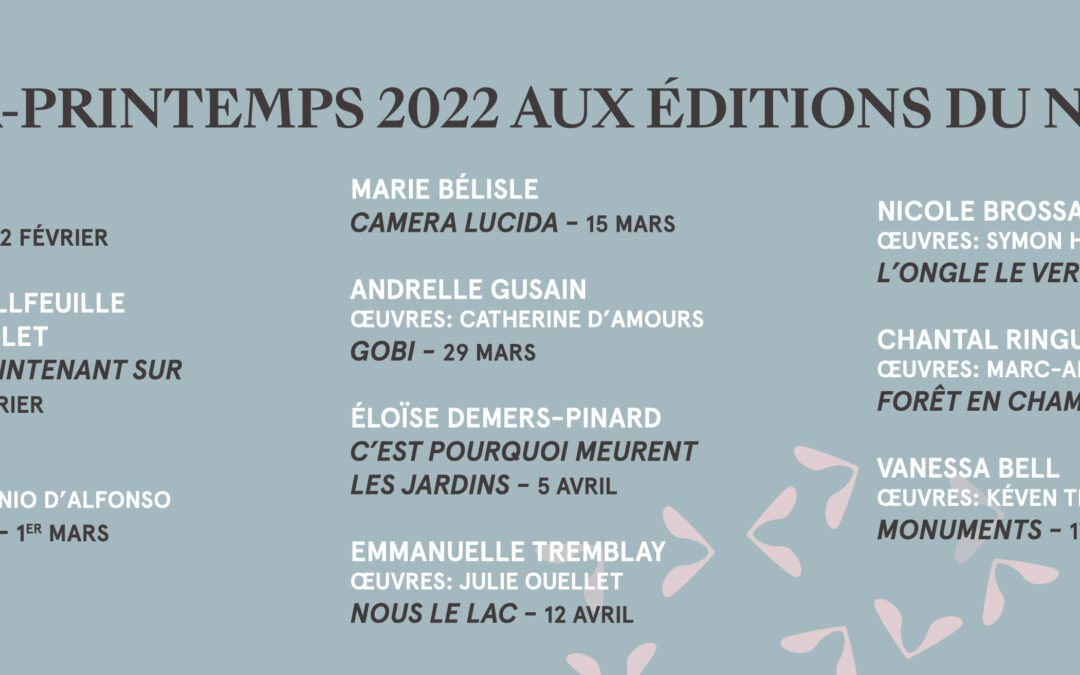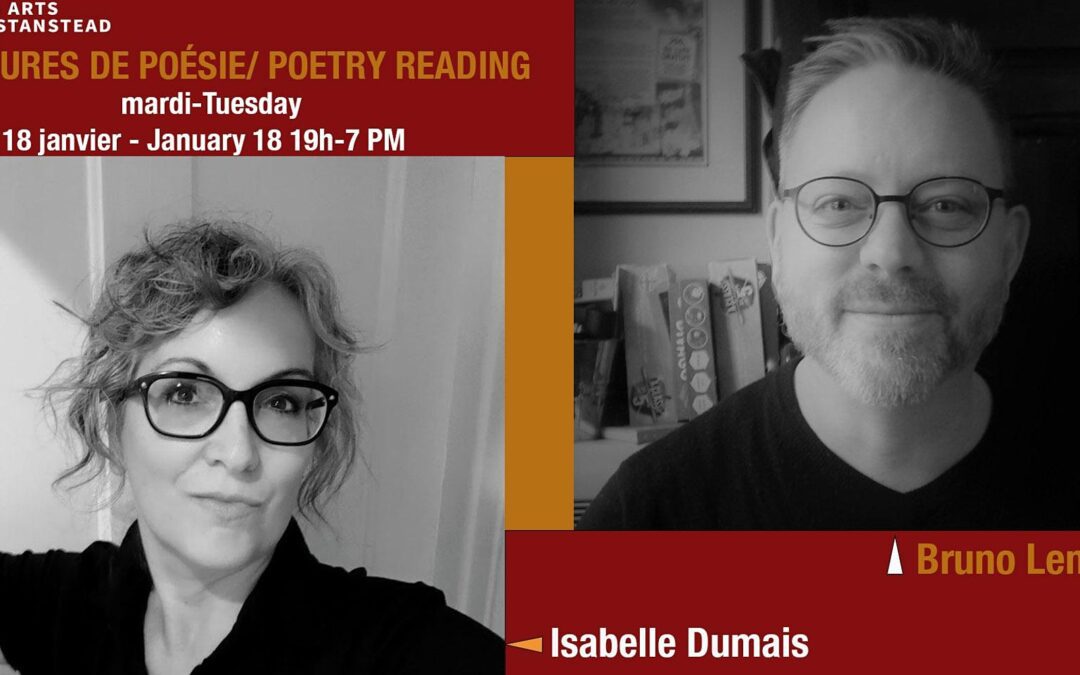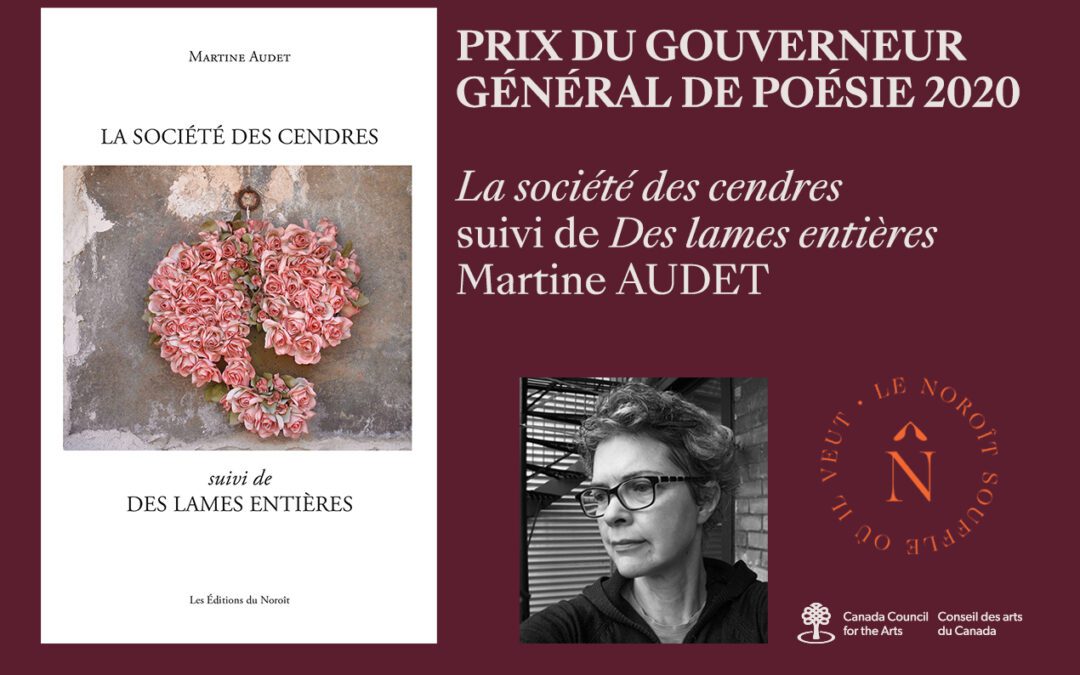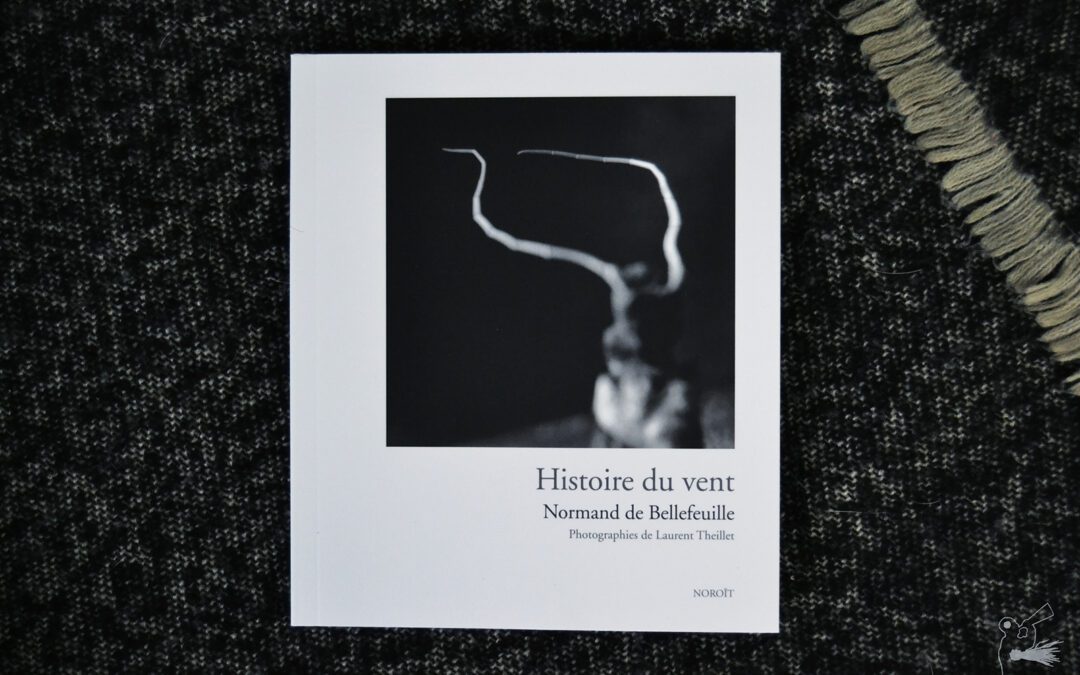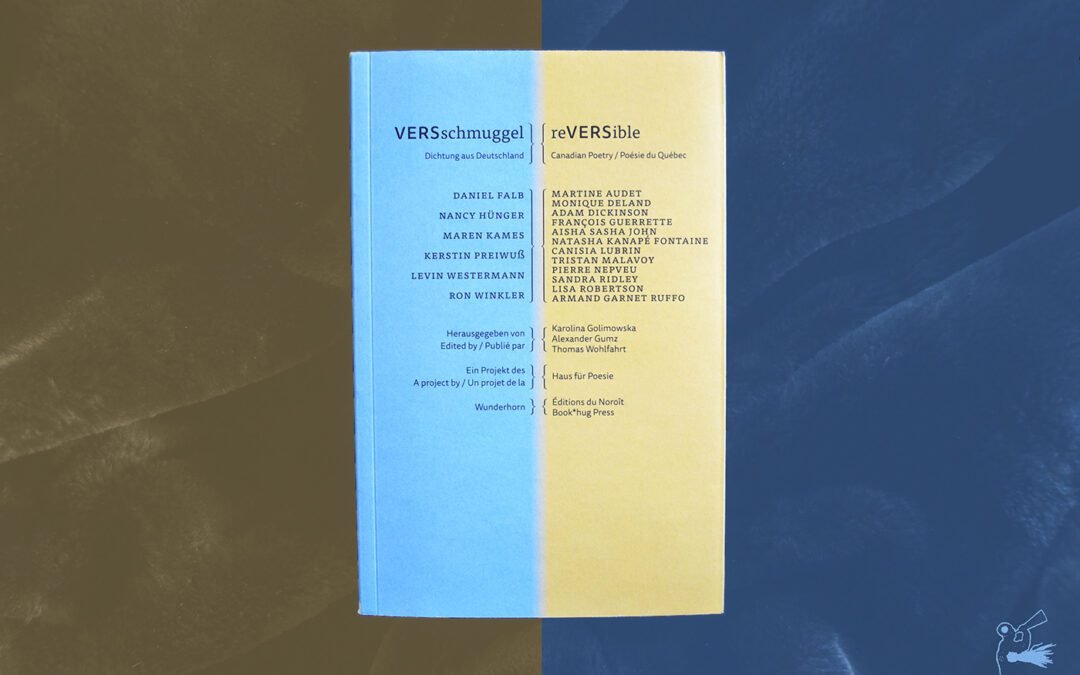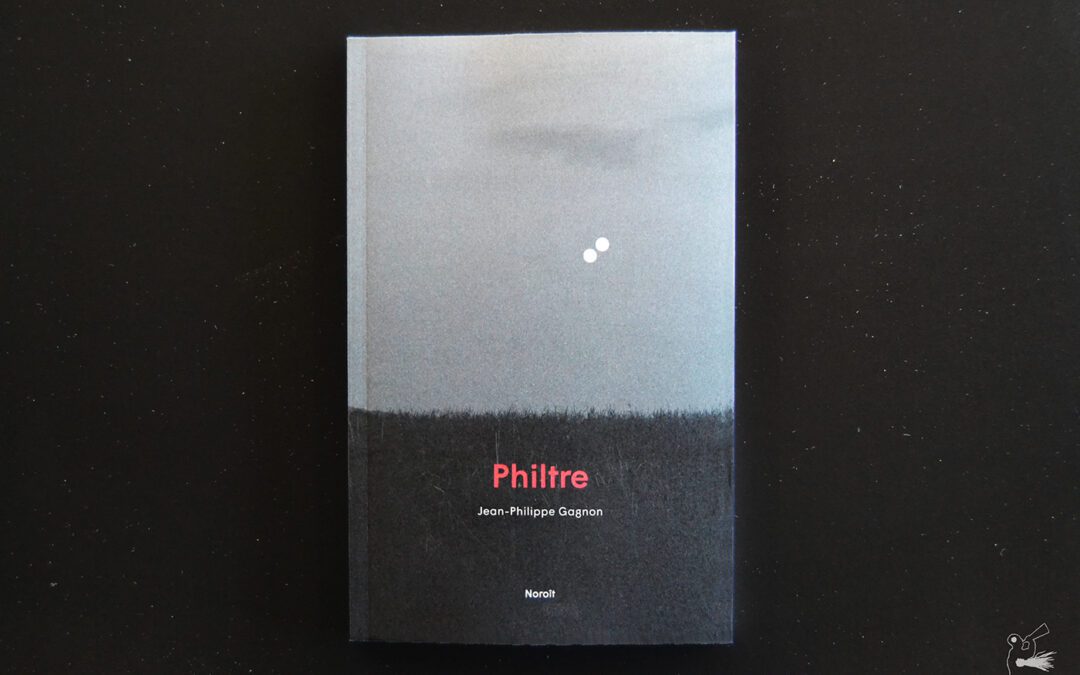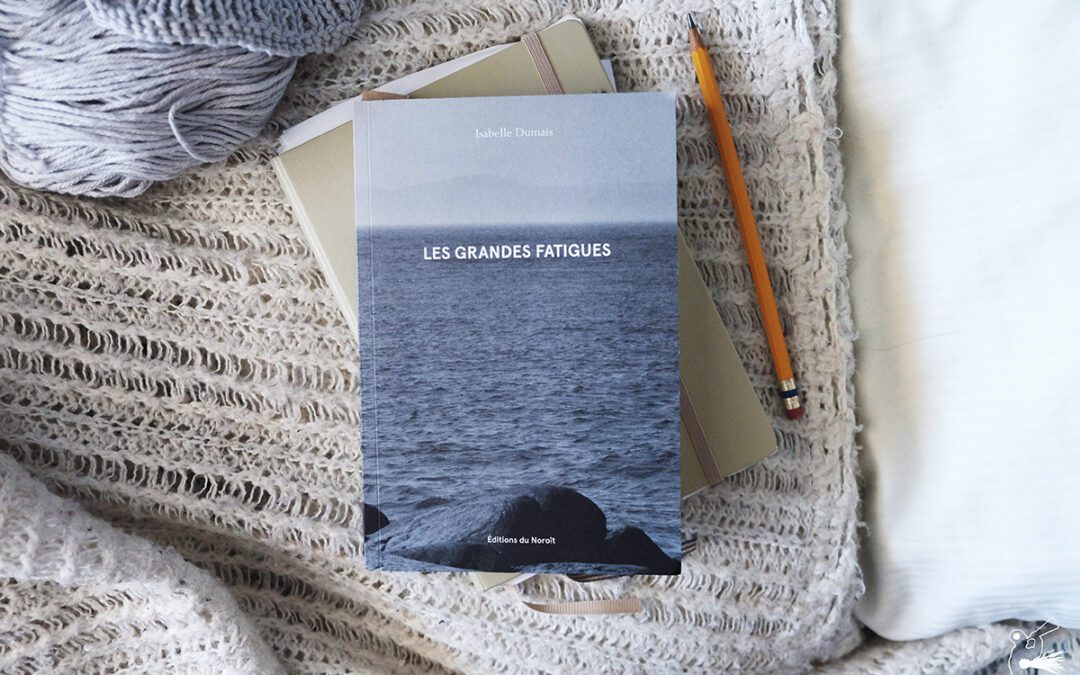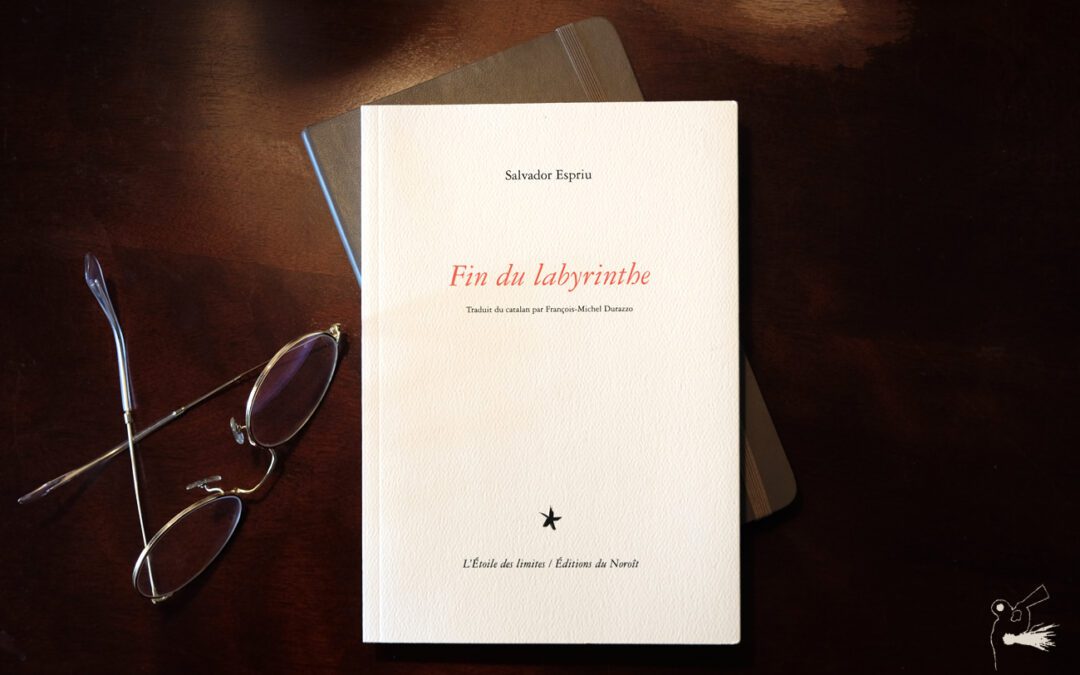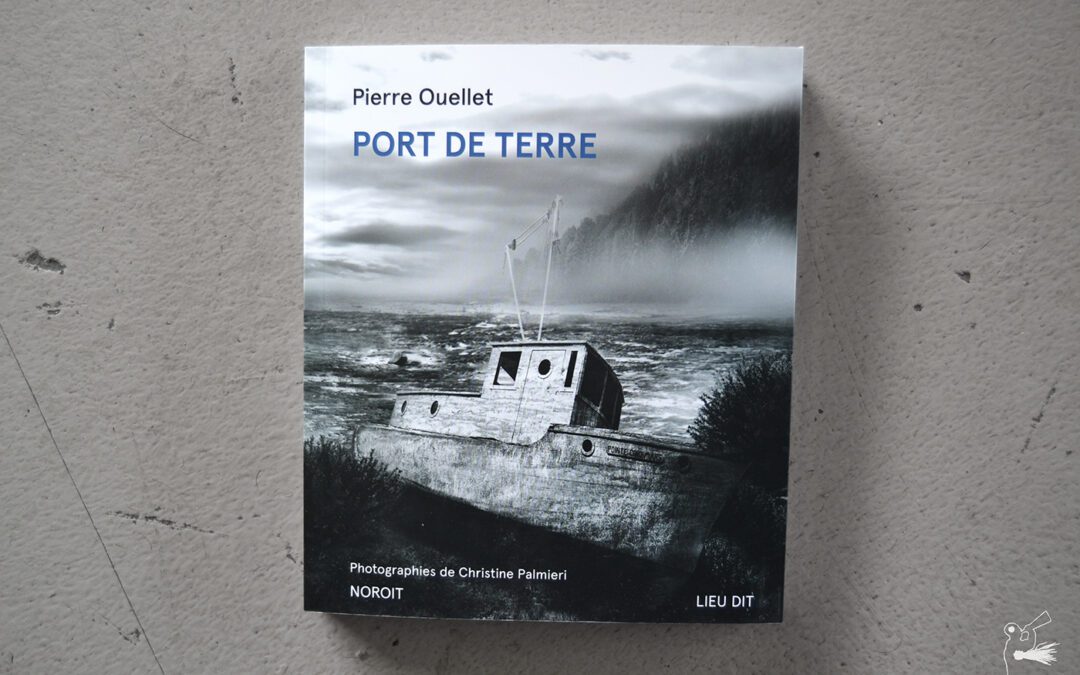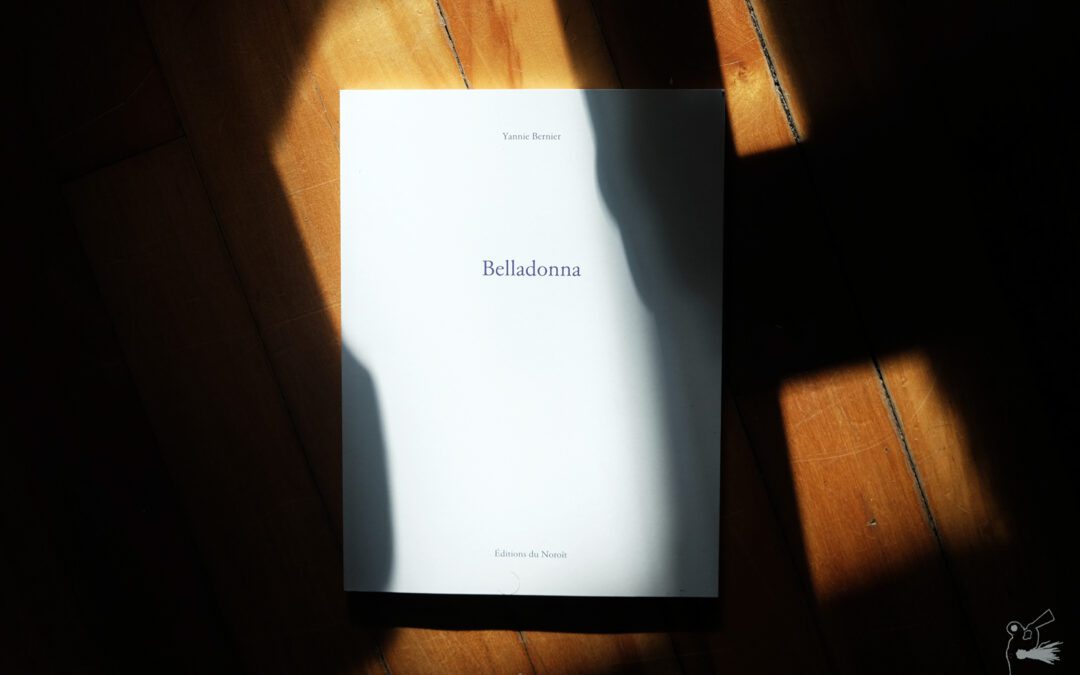Paul Bélanger, directeur littéraire au Noroît, s’est entretenu avec Michel Leclerc au sujet de la parution de son dernier recueil de poésie, Une brûlante inquiétude.
Paul Bélanger, directeur littéraire au Noroît, s’est entretenu avec Michel Leclerc au sujet de la parution de son dernier recueil de poésie, Une brûlante inquiétude.
Après la publication de Des mots au bord de la nuit, comment vois-tu le chemin parcouru depuis La traversée du réel?
Quarante ans séparent ces deux ouvrages. Le monde a changé entretemps, moi avec lui, ou plutôt moi au-dedans de lui. Je suis peu enclin à disséquer le chemin parcouru, j’aurais le sentiment d’être une sorte de prophète de l’après-coup. J’ai pris l’habitude très tôt de ne pas faire grand cas de mes livres. Non pas qu’ils m’indiffèrent ou que je ne m’y applique pas chaque fois. Il s’agit de tout autre chose. Je les laisse vivre sans moi, à grand peine s’il le faut, je les abandonne au lecteur, pour que « l’écriture se dissipe, sa tâche faite », selon la lumineuse formule d’Yves Bonnefoy. Je dirais, toutefois, que depuis la parution de La Traversée du réel, j’ai été fidèle à moi-même et que le chemin parcouru, aussi univoque qu’il m’apparaisse parfois, a été celui d’une loyauté sans faille à l’égard de la poésie conçue comme une autre vie. Ce pressant besoin qu’éprouvent tant de mes contemporains à mettre leurs ouvrages, et surtout eux-mêmes, de l’avant, m’est aussi étranger que le désir d’un autre monde. Je me reconnais pleinement dans les vers de Pessoa: « Être poète n’est pas une ambition pour moi/C’est ma façon d’être tout seul. »
Poésie et solitude sont les deux faces d’un même aimant. J’ai emprunté ce chemin difficile en toute conscience, mais sans toujours en connaitre le prix.
Ton livre précédant, Un refuge au milieu des flammes se voulait comme un hommage à Pablo Neruda, mais plus largement quel était ton intention avec ce livre?
Un refuge au milieu des flammes était moins un hommage proprement dit à Neruda que point de départ historique. En 1936, Neruda publiait l’Espagne au coeur, oeuvre de résistance produite en pleine Guerre d’Espagne. Or, cette guerre était tout autant annonciatrice de la guerre mondiale à venir, que de la barbarie à grande échelle qui allait marquer le XXe siècle. L’Europe et le monde avec lui entraient dans ces « temps sombres » annoncés par Hannah Arendt. Je pense que cet événement est fondateur de la barbarie actuelle, qu’il recèle en son sein la haine de l’opposant, le refus de celui qui est perçu comme l’étranger, à la fois de l’intérieur comme de l’extérieur,
La Guerre d’Espagne a entraîné l’exil d’environ 1 million de réfugiés espagnols, républicains ou non. La crise migratoire qui sévit en Europe, n’est d’une certaine façon que la continuation.
Un refuge au milieu des flammes tente de rendre compte de cette filiation entre la guerre civile de 36 et la barbarie des temps modernes: l’assassinat de victimes civiles, l’exil de masse, la haine de l’Autre, le refus de lui porter secours ou à lui reconnaître la moindre valeur. Ce livre aurait pu s’intituler Les Bannis, puisqu’ils étaient au coeur de son propos.
Je cherchais, avec ce livre, a évoquer la permanence d’une forme de barbarie au sein d’un monde qui, par fatigue et par lâcheté, s’en accommode.
Que ce livre ait été reçue dans l’indifférence des médias, illustre à l’évidence l’hypocrisie dans laquelle notre société s’est réfugiée. On exalte les discours d’ouverture et, en même temps, l’essentialisme identitaire, peu importe le terreau où il prend forme, a cadenassé l’opinion, on ne parle dorénavant librement qu’à ses risques et périls. Il faut être à tout prix du courant, sinon vous êtes condamnés à remonter sans cesse le chemin originel, tel un saumon incapable de s’extirper de son destin.
Il y a eu dans ta trajectoire, une interruption de publication, qui n’était peut-être pas un arrêt de l’écriture pour autant, que s’est-il passé dans ce temps de silence éditorial.
Ce « silence » était tout autant un choix éthique qu’une nécessité personnelle. Après la parution d’Écrire ou la Disparition, en 1982, il a fallu attendre 1997 avant que paraisse les Poèmes de l’infime amour. Gaston Miron s’amusait a dire: « Michel Leclerc est le seul poète du Québec qui a réussi son idéal poétique: après Écrire et la Disparition, on ne l’a plus vu pendant quinze ans. »
Ce livre défendait une option éthique radicale selon laquelle l’écrivain est un « être de trop » par rapport à son oeuvre. Je dirais volontiers, comme Flaubert dans une lettre à Georges Sand: « L’homme n’est rien, l’oeuvre est tout ».
Encore aujourd’hui, je soutiens que l’oeuvre seule compte, que l’auteur lui fait écran à la manière d’un encombrement inutile. Je rêve d’un âge où les livres seraient anonymes, jugés à leur seul mérite. Une idée qui parait démente aujourd’hui, j’en conviens. Bien sûr, la médiatisation de l’écrivain, qui obéit à des impératifs qui ont peu à voir avec la pertinence ou la qualité de ses oeuvres, reste un outil de promotion que la plupart des écrivains jugent essentiel. Elle contribue à la fois à la constitution de leur capital symbolique, c’est-à-dire leur renommée et donc leur influence, et de leur valeur marchande. Je ne reproche à aucun auteur de chercher à accroître sa visibilité. Il répond à une forme d’injonction implicite. Au fond, que demande-t-on à l’écrivain, sinon qu’il s’offre en spectacle? Pour ma part, je n’ai jamais cherché une quelconque renommée personnelle. En fait, depuis la parution de mon premier livre en 1972, j’y ai renoncé, quitte à en assumer le prix. D’une certaine façon, je ne joue pas le jeu, pire, j’ai volontairement brouillé le jeu, je vis et j’écris en marge de la communauté des écrivains. Ce n’est aucunement une position morale, simplement une volonté de vivre à l’écart. À force de n’être présent nulle part qu’ailleurs dans mes livres, de me « ducharmiser » comme disait encore Miron, j’ai plongé mes livres sinon dans une sorte d’oubli, du moins dans une certaine indifférence médiatique. J’en suis désolé pour mes livres, pas pour moi-même. Cela en dit beaucoup aussi, je crois, sur la place de la critique dans notre société.
La critique est devenue bête et servile, le plus souvent un instrument au service du narcissisme ambiant. Michel Tournier, à propos des jurés du Goncourt, parlait de « corruption affective ». Nous avons peu à peu chassé la critique pour y mettre à la place un interminable cortège d’opinions et de commentaires. Les médias y trouvent leur compte aux dépens de la littérature, devenue une marchandise économique parmi d’autres.
Avec ce nouveau livre, Une brûlante inquiétude, il semble qu’un cycle s’achève, que j’appellerais de résistance à la barbarie. Comment vois-tu cette dernière insertion?
Je partage ce jugement, du moins en partie. En effet, Une brûlante inquiétude clôt un cycle pour moi.
Cela dit, nous n’en finirons jamais avec la barbarie, elle se métamorphose sans cesse, se drape de nouveaux habits à la manière d’un virus en perpétuelle mutation. On pourrait affirmer, si on en élargissait le concept, que la barbarie est également au coeur de mon nouveau livre. Le sujet en est la parole, ce que j’appelle « le pêle-mêle de nos voix », cette parole multipliée à l’infini mais de plus en plus inaudible et dépourvue de sens. À aucune autre époque, la parole n’a-t-elle été accordée à tant d’humains. Dans ce bavardage de masse, le sens trouve laborieusement son chemin et la vérité y a moins d’importance que la puérile nécessité de parler de soi.
Jaccottet et Ungaretti, dans un chapitre de leur correspondance intitulé « la parole et le vide », évoquent cette homme contemporain qui ne parvient plus à parler, vaincu par une violence plus forte que la parole. « Nous sommes des hommes coupés de leur profondeur » concluent-ils. De parfaits barbares se sont emparés de la parole et ont pris le pouvoir. Je vois dans l’élection du président Biden le signe et l’espoir qu’ils sont en train d’échouer et qu’ils n’ont pas totalement déformés nos consciences.
Et que faire dans le futur?
J’ai l’habitude de dire que j’essaie d’écrire comme un boulanger fait son pain: sans y penser. C’est évidemment une demie-vérité. Mais c’est surtout une façon de rappeler que le métier d’écrivain n’a pas plus d’importance individuelle que celui de n’importe quel artisan.
Quant au futur, je sais moins que jamais quoi en attendre, ni quoi en faire, d’autant moins qu’il rétrécit comme peau de chagrin. Il n’est pas faux pourtant d’affirmer que je me soumets au « vent de l’éventuel », selon la formule d’André Breton. Je n’ai pas de boussole pour guider mes livres de demain. D’ailleurs, y en aura-t-il d’autres. Et dans quel but? Cette question réveille en moi une inquiétude que la parole ne peut à ce jour résoudre totalement. C’est comme tenter de venir à bout d’un secret. Ou de prédire qui je serai quand tout cela n’aura plus la moindre importance.